Climat, féminisme, marches de chômeurs, migrants, Gilets Jaunes… des mouvements sans leaders, qui ne répondent pas à l’appel d’une organisation précise. Cependant ils ne surgissent pas de nulle part mais d’ailleurs que de structures leur préexistant. Ils disent refus des « interprètes » qui finissent par parler (et penser) à la place des intéressé/es. La volonté de se doter de leur propre forme d’organisation a entrainé parfois des commentaires dédaigneux sur le « refus de l’organisation » (crime de lèse-majesté ?). L’impact de ces regroupements apportent un démenti. A chaque fois c’est de faire ensemble qui crée leur Nous.
On ne fait plus confiance qu’à soi-même et aux autres soi-même. Ce souci d’indépendance est une reconquête de soi que les désillusions, le sentiment d’impuissance devant ce qui tombe d’en haut a fait perdre. C’est un début de réponse à « être ou ne pas être » comme dit quelqu’un. Le refus des étiquettes de s’aligner derrière un emblème, est inhérent à ce désir d’être et pour être, d’être ensemble. La médiation d’une autorité surplombante qui échappe aux Je et demande que l’on s’identifie à elle, est source d’identifications clivantes. Ne sous-estimons pas les rapports interpersonnels. Les représentations collectives découlent de consciences qui agissent et réagissent les unes sur les autres. Nous voici à l’opposé des théorisations hâtives sur l’individualisme.
Pas de Nous durable sans commun allant de nos racines à notre devenir.
Nos racines communes passent par situer l’antagonisme de classes. Les salarié/es de Décathlon en dénonçant le milliard de dividendes, reçu par la direction du groupe, sont en train de construire un Nous. Mais c’est aussi à travers le devenir qu’on situe ses racines. La multiplicité des situations et des sensibilités renforce la nécessité de se lire à partir de l’antagonisme et du devenir. Il n’y a pas de Nous sans une intention qui parte de chaque Je et dans laquelle chaque Je se retrouve. Ce qui fait d’être un peuple. Ce qu’exploite l’extrême-droite. Pourquoi pas un Nous révolutionnaire ? Les services publics et ce qui doit le devenir pourraient être gérés comme la Sécu à ses débuts par les travailleur/ses et usager/es associé/es. Cette notion d’associé/es porte un Nous. C’est une définition du communisme de Marx. Bien sûr, il y a l’emprunte des échecs de l’URSS et répétés de la gauche au pouvoir. Mais ces moments avaient été conçus en dehors des JE dont le rôle se limitait à soutenir les leaders.
La construction d’un nouveau NOUS n’est pas un vœu pieux.
Aux législatives, pour faire face au RN, la mobilisation populaire a été décisive. Ne nous leurrons pas : l’appel du NFP n’a pas tout créé. Il faisait écho à un déjà acquis idéologique qui potentiellement portait une réaction collective. On juge de moins en moins sur les déclarations et de plus en plus sur les actes auxquels on peut participer. C’était ça le vote NFP. Dommage que celui-ci n’en ait pas prolongé le sens. Avancer par glissement du « déjà là » au « pas encore là », est ce que les neuropsychologues appellent « zone de proche développement ». Où est aujourd’hui cette zone de proche développement ? Contre la vie chère ou le chômage, que serait un premier passage possible au « pas encore là » ? Exiger que l’argent public livré aux entreprises du CAC 40 et les dividendes qui ne participent à rien, contribuent aux dépenses sociales (à la fois antagonisme et devenir).
Et le passage à un Nous global ? Quand les Nous regroupés par thème percevront qu’ils ont tous un dénominateur commun : la maitrise de l’économie et le pouvoir décider : autant dire une « Nous-cratie ».
Pierre Zarka
Image : ©https://mencoboni.com

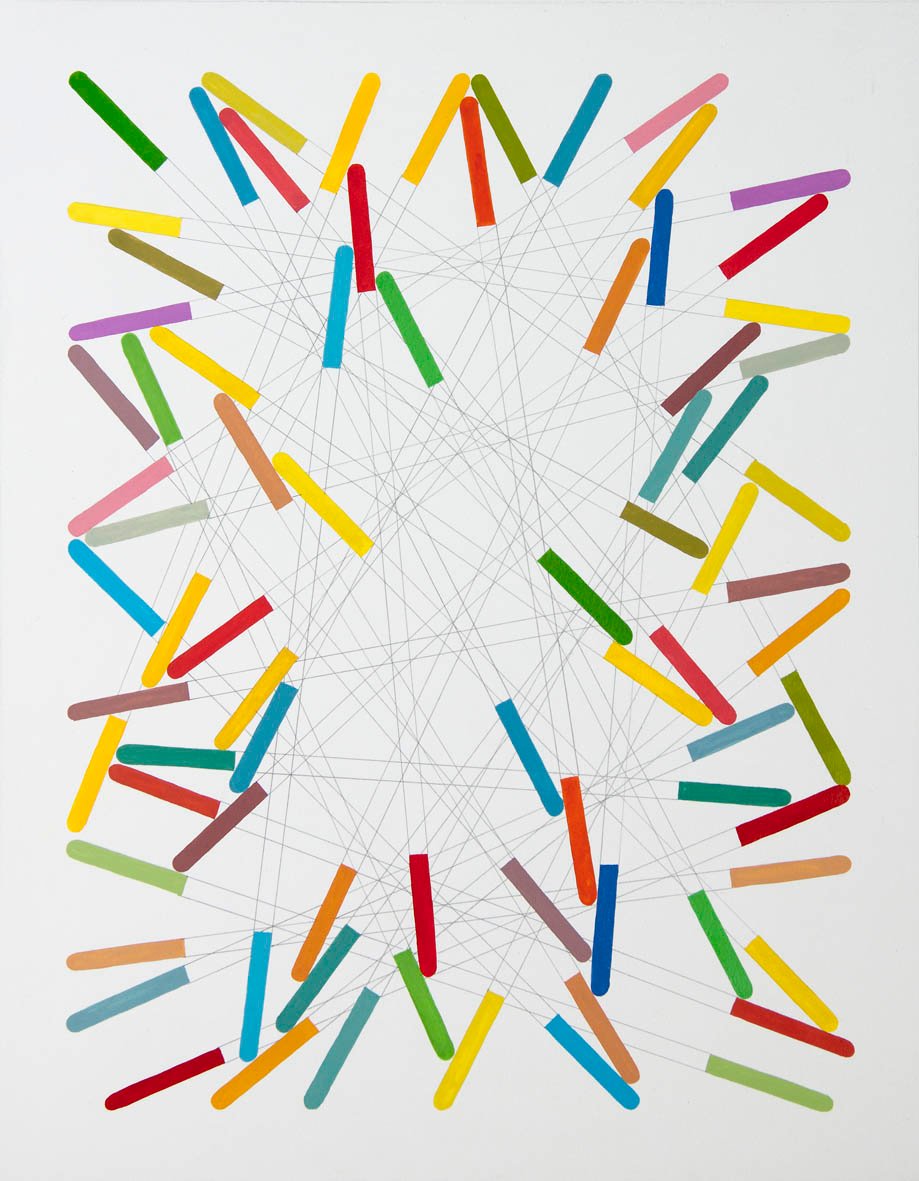
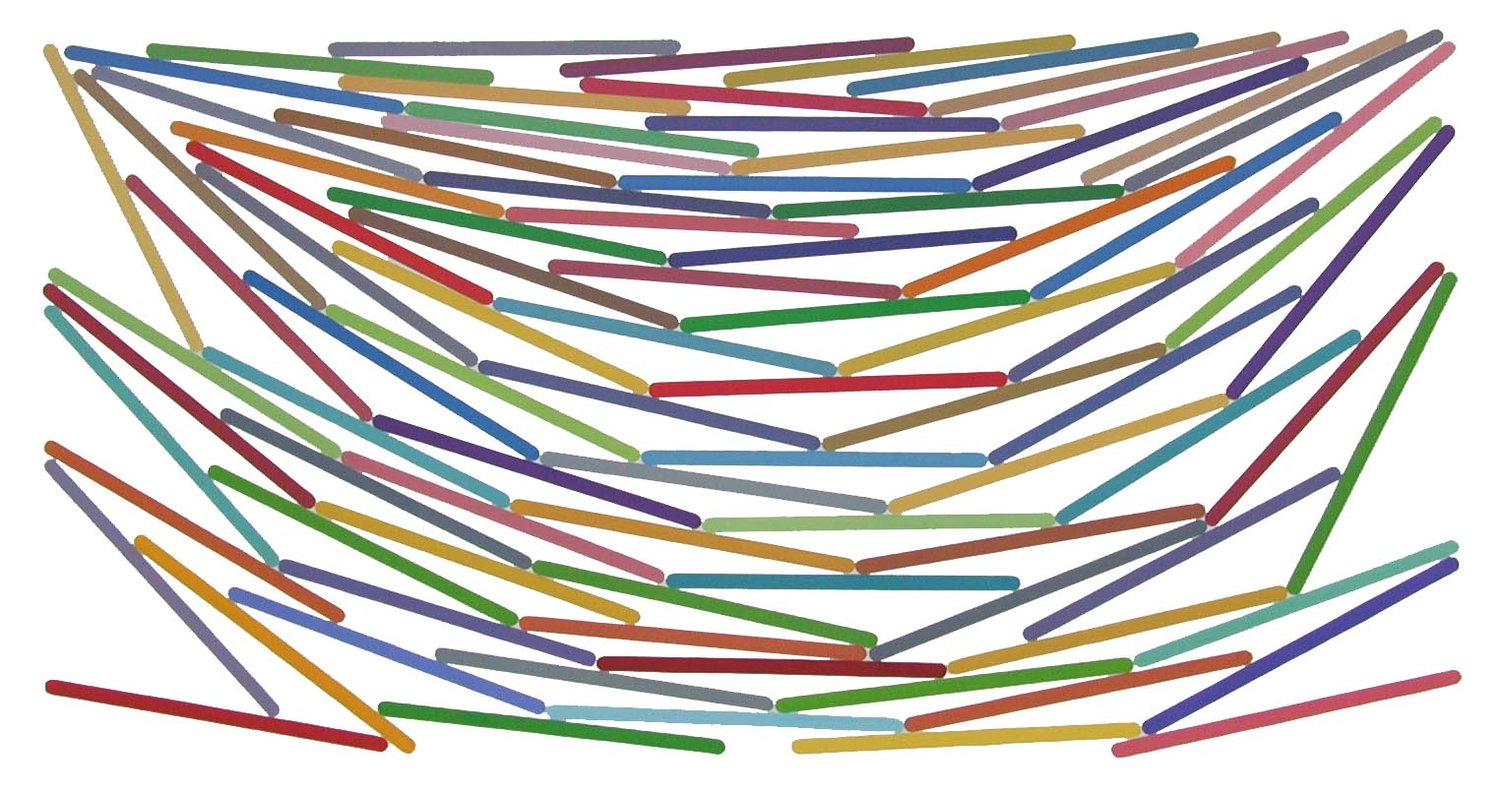

A lire également
Quid de l’organisation révolutionnaire ?
Le conflit pour faire démocratie
Rennes, une citoyenne à la mairie