Louise Michel, les Kanak …
Rescapés de la Semaine sanglante , 4500 communards sont condamnés au bagne, Louise Michel en est. En prison avant le départ puis en Nouvelle-Calédonie les fédérés côtoient les combattants kabyles du plus grands soulèvement anticolonial d’Algérie de 1871. Ce lien érode leur adhésion forte au projet colonial de la République1. Trop peu pour interroger la question Kanak. Ainsi, Communards et révoltés Kabyle seront au côté de l’administration française, contribuant pour une part à l’anéantissant la grande révolte Kanak de 1878.
Nouant vers les déportés algériens des liens de fraternité, les bagnards communards, entre ignorance et dédain des Kanak, sont européens de leurs temps. Ils adhèrent aux théories racistes des anthropologues et explorateurs qui faisaient des Kanak des « préhistoriques sans Histoire »2
Si durant 4 mois de voyage, Louise Michel, socialiste blanquiste, s’empare des thèses anarchistes auprès de Nathalie Lemel (1827-1921)3, c’est néanmoins avec les mots du racisme qu’elle désigne les Kanak. Son approche évolutionniste de leur culture est marquée par la théorie anthropologique du XIX è siècle qui postule un mode d’évolution linéaire des sociétés, sur le modèle unique du développement de la société occidentale. Elle pense, comme la plupart des commentateurs de la fin XIX e siècle : « qu’une éducation occidentale [peut] « sauver » les Kanak qu’elle décrit souvent comme des enfants capables d’apprendre rapidement ».4
De façon contradictoire Louise Michel est curieuse, respectueuse envers ses voisins Kanak. Elle reconnait notamment la légitimité de leurs luttes. Forte de ses convictions anarchistes, elle est « tellement critique envers la culture française dominante et la société bourgeoise, envers les relations de genre, de classe » 5qu’elle remet en question nombre de stéréotypes, s’ouvre à ce qui l’entoure. Féministe, elle met des mots, du sens, sur l’inégalité d’avec les hommes, dont elle est l’objet, dont sont l’objet toutes les femmes. Sa réflexion féministe qui réinstalle les femmes parmi le genre humain lui permet de percevoir le déni d’humanité dont les Kanak sont l’objet. Pour sa part Carolyn Eichner6 considère que l’engagement féministe de Louise Michel l’a conduite à questionner les rapports de domination au sein de la colonie néocalédonienne :
« Il y a du féminisme dans sa manière de dénoncer l’oppression des Français sur les Kanak qu’ils perçoivent alors comme leur propriété. Son féminisme, anarchiste, était ce qu’on appellerait aujourd’hui intersectionnel au sens où elle ne regardait pas seulement le genre, mais également les manières dont il s’articule avec la race et la classe. »7
Anarchiste elle ne se soumet pas à la doxa étatique, coloniale en l’occurrence. Ce n’est pas le cas de ses compagnons masculins qui participeront au massacre des Kanak en 1878.
À leur encontre, s’intéressant et publiant quant à la culture Kanak elle est en capacité de changer de regard, et donc de manifester sa solidarité aux insurgés de 1878. Elle produit ainsi de l’inouï en favorisant l’émergence d’une opposition au projet impérialiste d’état.
Les Communards ne reconnurent guère aux colonisés Kanak de porter les idéaux d’autodétermination de la Commune, Louise Michel en souffre, « Comment n’êtes-vous pas avec eux, vous, les victimes de la réaction, vous qui souffrez de l’oppression et de l’injustice ! Est-ce que ce ne sont point nos frères? Eux aussi luttaient pour leur indépendance, pour leur vie, pour la liberté. Moi, je suis avec eux, comme j’étais avec le peuple de Paris, révolté, écrasé et vaincu. »8 Un geste symbole lia son combat à celui des Kanak. De nuit, deux combattants anticoloniaux lui font leurs adieux : « Alors cette écharpe rouge de la Commune que j’avais conservée à travers mille difficultés, je la partageai en deux et la leur donnai en souvenir. »9
Catherine Destom Bottin
Notes
1,5,6,7 Delaporte, Lucie., « Louise Michel et les Kanak: amorce d’une réflexion anti-impérialiste ». Médiapart, 23 août 2018
2 Dotte, E., 2017. « How Dare Our ‘Prehistoric’ Have a Prehistory of Their Own?! The interplay of historical and biographical contexts in early French archaeology of the Pacific », Journal of Pacific Archaeology 8 (1), p. 31.
3 Militante de l’Association internationale des travailleurs, féministe, Communarde, membre du Comité Central de l’Union des femmes pour la défense de Paris
4 Théorie anthropologique du XIXe siècle postulant un mode d’évolution linéaire des sociétés, sur le modèle unique du développement de la société occidentale.
6 Carolyn Eichner historienne étasunienne, professeure associée au département d’histoire et d’études de genre à l’université de Milwaukee .
8, 9 Baronet, J. et Chalou, J.,1987. Les Communards en Nouvelle-Calédonie. Histoire de la déportation. Paris, Mercure de France, p. 321.



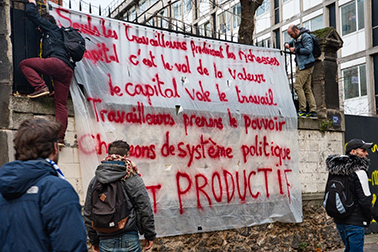


Merci