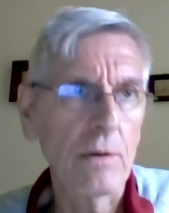
Les lignes qui suivent constituent un essai visant à analyser les rapports existant (ou non) entre un certain nombre de phénomènes qui sont apparus et ont eu tendance à se renforcer au cours des dernières années, en prolongeant cependant quelquefois des tendances plus anciennes. Il s’agit du durcissement autoritaire des Etats centraux (1) ; du renforcement des mouvements d’extrême droite dans ces mêmes Etats (2) ; de la radicalisation des politiques néolibérales (3) ; de l’émergence des BRICS+ (4) ; de la montée en puissance des Gafam (5) ; enfin du développement de l’intelligence artificielle (6).
Précisons d’emblée que je n’ambitionne ici que de livrer quelques réflexions et éléments d’analyse qui ne prétendent à aucune exhaustivité et laisseront bien des questions en suspens. Ils sont fonction de l’état actuel de mon information et de mes connaissances à leur sujet, dont le caractère lacunaire ne m’échappe pas. Je les livre néanmoins afin de nourrir le débat, en espérant que ce dernier permettra de les enrichir.
La principale question qui se pose au sujet de ces différents phénomènes est de savoir dans quelle mesure et en quoi ils constituent des nouveautés. Sont-ils de nature à faire époque en introduisant des ruptures par rapport au devenir antérieur de notre monde (capitaliste), voire à bouleverser ses structures les plus fondamentales (les rapports de production, les rapports de classe, les rapports internationaux, etc.), comme l’ont aussitôt déclaré un certain nombre de leurs analyses ? Ou s’agit-il au contraire simplement de nouvelles formes sous lesquelles ces mêmes rapports sont destinés à se reproduire ? Sont-ils intelligibles à partir de nos catégories traditionnelles (celles constituées dans et par la riche tradition marxiste) ? Ou, au contraire, défient-ils l’intelligibilité que nous offrent ces catégories ?
1. Sur le durcissement autoritaire des Etats centraux
Les trois premiers de ces phénomènes renvoient aux difficultés grandissantes et aux limites de plus en plus évidentes des politiques poursuivies par les gouvernements de ces États depuis près d’un demi-siècle, maintenant, signifiant l’épuisement du paradigme néolibéral qui les a inspirées. Cet épuisement se manifeste tant dans le fait que ces politiques n’ont permis qu’en partie d’atteindre les objectifs qui leur étaient assignés que par les résistances multiples et persistantes qu’elles ont suscitées.
Cet article s’intègre au débat proposé par la rédaction de Cerises la coopérative “Nouveau monde? Nouveaux défis!. Voir la problématique ICI
Face à ce constat, la première réaction des gouvernants a été de durcir leur mode de gouvernement. En l’occurrence de porter atteinte à différents éléments constitutifs de l’Etat de droit : de restreindre le champ des libertés individuelles et surtout publiques (liberté d’expression, d’association et de manifestation) ; de renforcer l’arsenal répressif (policier, judiciaire, pénitentiaire) et de durcir considérablement la répression des mouvements sociaux (celle du mouvement des « gilets jaunes » en France a été emblématique à cet égard) ; de réduire encore la portée de la démocratie représentative, en accroissant un peu plus le déséquilibre en faveur du pouvoir exécutif (gouvernement et administration), etc. La lutte contre le terrorisme islamiste aura servi d’occasion et de prétexte à l’ensemble de ces dérives, tandis que l’idéologie sécuritaire, ressassée depuis le milieu des années 1970, leur aura servi de justificatif.
Autant et plus inquiétante peut-être est la manière dont, avec la complicité des directions des principaux médias (presse, radio, télévision, réseaux sociaux numériques), les gouvernants sont parvenus récemment à entraver largement toute possibilité pour un discours alternatif de venir contester la « vérité » officielle au sein même de ces médias et, plus largement, au sein de l’espace public. Il en a été ainsi tant en ce qui concerne tant la guerre en Ukraine que la destruction de la bande de Gaza.
Mais cette dégradation des conditions d’exercice de la démocratie dans les Etats centraux n’a pas été le fait des seuls gouvernants. Des mouvements de fond affectant plus largement l’espace public y ont également participé. Il faut ici incriminer l’emprise et le mode de fonctionnement des réseaux sociaux numériques : la façon dont ils favorisent la diffusion virale des fake news ; la manière dont ils fragmentent l’espace public en enfermant les différents publics dans leurs « bulles » de représentation et en confortant « leurs œillères mentales » ; la manière dont ils captent en permanence l’attention de leurs usagers-participants en les coupant les uns des autres et en atrophiant leurs échanges directs dans l’espace public, etc. Ce qui nous renvoie au point 5.
2. Le renforcement des organisations d’extrême droite
Ce dernier s’observe dans l’ensemble de l’Europe quoique de manière inégale selon les Etats, depuis le début des années 1980 avec une accélération cependant au cours de ces dernières années. Mais le même phénomène s’observe aussi ailleurs dans le monde, essentiellement sous la forme ou sous couvert de fondamentalismes religieux : l’évangélisme aux Etats-Unis et en Amérique latine, le courant ultra orthodoxe au sein du judaïsme en Israël, l’islamisme dans toute l’aire musulmane, le fondamentalisme hindouiste en Inde.
Ce mouvement est concomitant de deux autres en fonction desquels il convient, à mon sens, de le comprendre : le développement des politiques néolibérales, l’affaiblissement voire l’effondrement des organisations traditionnelles (partis, syndicats, associations) socialistes au sens large (celles se chargeant de la défense des intérêts immédiats du monde salarial et se proposant de l’émanciper de l’exploitation et de la domination capitalistes) et de leurs idéologies. L’hypothèse interprétative que j’avancerai dès lors est que ces mouvements trouvent leur base sociale et électorale dans les éléments des différentes classes, fractions de classe et couches sociales (prolétariat, petite-bourgeoisie, encadrement, petit et moyen capital) qui, d’une part, ont été victimes, se trouvent menacés ou craignent d’être menacés par les politiques néolibérales, notamment en ce qu’elles fragilisent les États-nations et les équilibres sociopolitiques sur lesquels ils reposent, et que, d’autre part, les organisations socialistes ne parviennent pas ou plus à mobiliser voire ont renoncé à chercher à mobiliser. Le projet de ces mouvements d’extrême droite est dès lors de constituer ces différentes classes, fractions et couches sociales en un bloc social (un système stable d’alliances de classes) capable de leur permettre d’accéder au pouvoir, aux différents niveaux de ce dernier (de l’échelon local à l’échelon national), et de l’exercer de manière continue dans le but de pratiquer une forme ou une autre de national-libéralisme, combinant à la fois la défense des intérêts nationaux sur le plan international (ce qui impliquent le contrôle des mouvements des marchandises et des capitaux aussi bien que des personnes aux frontières) tout en livrant la formation nationale (à l’intérieur des frontières) au libre mouvement du capital et des intérêts privés plus largement.
Sur la base d’une pareille orientation, ces organisations peuvent s’associer à des organisations néolibérales dans l’exercice du pouvoir, moyennant négociations et compromis, donc inflexions plus ou moins notables du projet précédent. Aussi a-t-on assisté au cours des deux dernières décennies, en plus de séquences de gouvernement majoritaire de l’extrême droite (Pologne, Hongrie), à la multiplication en Europe des alliances gouvernementales entre forces néolibérales et forces d’extrême droite (Autriche, Hongrie, Italie, Norvège, Finlande, Pays-Bas, Suisse) ou à des expériences de gouvernements néolibéraux soutenus par des forces d’extrême droite sans participation de ces dernières au gouvernement (Danemark, Norvège, Suède). Et de pareilles alliances, combinant de différentes manières des éléments néolibéraux avec des éléments d’extrême droite, ont également vu le jour ailleurs qu’en Europe : qu’on pense par exemple à Trump aux Etats-Unis, à Bolsonaro au Brésil, à Miliei en Argentine (cf. le point suivant à son sujet), à Erdoǧan en Turquie, à Netanyahu en Israël, à Modi en Inde, etc. Pour les organisations néolibérales, c’est une manière de compenser le discrédit politique relatif en se trouvant des alliés, des appuis ou des relais ; pour les organisations d’extrême droit, c’est le moyen d’accéder à un pouvoir qui se déroberait à eux sans cela et de gagner en légitimité en se « normalisant ».
Au vu de ce qui précède, il semble nécessaire de récuser la thèse qui voit dans la montée en puissance de ces organisations d’extrême droite et leur participation au pouvoir sous différentes formes l’antichambre du fascisme. Outre que les conditions historiques du fascisme ne sont pas (plus) réunies[1], la principale différence entre ces organisations et le fascisme historique tient à leur attitude à l’égard des organisations socialistes. Même si elles sont hostilement disposées à l’égard de ces dernières, en les combattant idéologiquement et en se proposant d’en amoindrir le poids politique, elles ne visent absolument pas à les détruire physiquement. Tout simplement parce que cela ne fait pas (pas encore ?) partie des impératifs de la poursuite de la domination capitaliste. Ce qui ne préjuge en rien de ce qu’il en serait si et quand cela devait devenir le cas. Ce qui nous renvoie au point suivant.
3. La radicalisation des politiques néolibérales
Au fur et à mesure de leur développement depuis le tournant des années 1980, les politiques néolibérales, tout en réalisant une partie de leurs objectifs, ont engendré, outre des résistances plus ou moins fortes, un certain nombre d’effets pervers : des effets inattendus de ceux qui les ont conçues et mises en œuvre et venant à l’encontre des buts poursuivis, voire directement contraires à ces derniers, mettant en évidence les erreurs et les illusions sur lesquelles ces politiques reposent, qui signent en même temps leurs limites pratiques. Mais, loin de renoncer à leurs mises en œuvre, les néolibéraux en ont régulièrement déduit qu’il était nécessaire et urgent de persister dans la même voie en redoublant d’efforts en ce sens : si la réalité démentait la théorie, c’est qu’elle avait tort et qu’il convenait de la réformer jusqu’à ce qu’elle vérifie la théorie. C’était évidemment là le signe d’une pensée dogmatique marquée au coin du fétichisme capitaliste[2].
Cette radicalisation progressive de la mise en œuvre des politiques néolibérales s’est soldée par leur durcissement autoritaire, allant jusqu’à la brutalisation de certains segments de la population, notamment dans les couches populaires (pensons par exemple à la mise en œuvre des politiques de workfare, à la politique pénale et pénitentiaire, à la chasse aux immigrés « sans papiers », etc.), sans compter la répression de plus en plus brutale des résistances qui leur étaient opposées (cf. le point 1). Mais il semble bien qu’on en soit désormais arrivé à un saut qualitatif, en l’occurrence la transformation du néolibéralisme en libertarianisme. Frère jumeau du néolibéralisme, né comme lui des travaux des intellectuels libéraux qui, dans les années 1930, ont cherché à sauver le libéralisme classique de sa déconfiture face au fascisme et au socialisme et qui se regrouperont après guerre dans la Société du Mont-Pèlerin, le libertarianisme peut être considéré comme une forme radicale de néolibéralisme. S’il en partage nombre de postulats (l’attribution à l’individu de droits naturels inaliénables, au premier rang desquels la propriété de soi et de ses biens et la liberté de choix ; la croyance dans la capacité autorégulatrice des marchés ; la prévalence attribuée au contrat sur la loi), il lui adjoint l’idée qu’il faut pousser la dérégulation des marchés à bout, en réduisant l’Etat à une formule minimale (minarchisme) voire en se passant de tout Etat (anarcho-capitalisme), en liquidant donc toute forme d’Etat-providence et de droit social tout comme l’intégralité du secteur public.
Javier Milei, élu président de la République argentine en décembre 2023, s’en revendique (avant son élection, il a été le leader du Parti libertarien), tout comme certains membres de l’administration de Donald Trump, à commencer par Elon Musk. Et l’avalanche de mesures prises par le premier, tout comme la nomination du second à la tête d’une agence charge du « dégraissement » de l’Etat fédéral, le Department of Government Efficiency (DOGE), s’inscrivent clairement dans une perspective libertarienne.
Si ce saut devait se confirmer en se généralisant au sein d’autres Etats, il préfigurerait sans doute des agressions graves contre les salariés des administrations publiques tout comme, plus largement, contre l’ensemble des classes populaires via le démantèlement du droit du travail et de la protection sociale. La résistance que ne manqueraient pas d’y opposer les travailleurs et leurs organisations syndicales pourrait alors ouvrir la voie à une radicalisation ultérieure du pouvoir capitaliste, visant cette fois-ci directement ces organisations. Le libertarianisme paverait-il la voie vers le fascisme ?
Signalons que la transmutation du néolibéralisme en libertarianisme fait d’ores et déjà une victime de poids : la question écologique, dont l’importance et l’urgence ne sont plus à démontrer. Car si le néolibéralisme n’a été capable jusqu’à présent de traiter cette question qu’à minima, en en faisant toujours trop peu et trop tard, le libertarianisme, pour sa part, est résolu à l’ignorer purement et simplement, en cultivant et en promouvant un solide déni négationniste à son égard. La récente fermeture, sous injonction de l’administration Trump, de toutes les pages qui y étaient consacrées sur les sites des différents ministères et agences qui l’avaient en charge jusqu’à présent, en est une illustration. Ce déni signe la radicalité (la brutalité) avec laquelle le libertarianisme entend écarter tous les obstacles qui peuvent se dresser sur sa route, en même temps que la profonde irrationalité qui l’anime. Si le néolibéralisme s’est caractérisé par la volonté de plier coûte que coûte la réalité à ses dogmes, le libertarianisme pour sa part se propose tout simplement de faire fi de la réalité.
Ce qu’illustre plus largement son recours à ce que Richard Hofstadter a appelé « le style paranoïaque en politique »[3], mêlant précisément déni de réalité, mensonges, inventions de fake news, brutalité du propos (insultes) et du comportement (agressivité), menaces à l’encontre des adversaires politiques, mégalomanie de l’acteur et de ses projets. Le tout centré sur l’idée d’un complot ourdi par une puissance maléfique, en l’occurrence les forces de gauche et les mouvements écologistes, féministes, antiracistes, « wokistes », etc. On aura reconnu l’ordinaire des discours de Donald Trump, aux accents souvent ubuesques.
4. L’émergence des BRICS+
Née du regroupement en 2009 du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine, rejoint en 2011 par l’Afrique du Sud, cette alliance s’est récemment élargie (en 2024) à l’Egypte, à l’Ethiopie, aux Emirats arabes unis, à l’Iran et à l’Indonésie. Elle vise à coordonner et conforter les ambitions de ces Etats au sein de l’arène internationale.
Son noyau originel (les BRICS) est composé de cinq « Etats émergents », c’est-à-dire d’anciens Etats semi-périphériques, périphériques ou même marginaux (s’agissant de la Russie et de la Chine) qui sont parvenus, dans le contexte de la transnationalisation du capital induite par les politiques néolibérales lancées au tournant des années 1980, à s’élever dans la hiérarchie de la division internationale du travail et du système mondial des Etats jusqu’à prétendre intégrer le club fermé des Etats centraux, en se heurtant aux positions acquises par les anciens Etats centraux de « l’Occident global » (Etats-Unis, Union européenne, AELE, Japon, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande) qui n’avaient pas l’intention de leur céder la place ou tout simplement de leur ménager une place au sein de ce club et ne l’ont toujours pas.
En conséquence, ces Etats cherchent actuellement à constituer un pôle alternatif destiné à rivaliser avec le pôle « occidental » en s’en donnant d’ores et déjà quelques moyens : les échanges commerciaux entre eux se règlent actuellement en yuans et non plus en dollars, ils ambitionnent à terme d’instituer une monnaie commune capable de concurrencer le dollar, l’euro et le yen, et ils ont fondé une Nouvelle banque de développement qui entend concurrencer la Banque mondiale dans le financement des projets de développement des formations semi-périphériques et périphériques, que les BRIC+ pourraient du coup transformer en autant d’alliés ou d’appuis.
Cela dit, le projet n’est pas sans présenter des fragilités et des sources de contradictions. D’une part, paradoxalement et contradictoirement, l’émergence de ces Etats doit elle-même quelque chose à « l’Occident global » sous la forme de la transnationalisation d’une partie du capital de ce dernier. Le cas de la Chine est tout à fait emblématique à ce sujet : sans les flux massifs de capitaux (industriels et financiers) d’origine états-unienne, européenne et japonaise (en y ajoutant Hong Kong, Taiwan, Singapour et la Corée du Sud) qui sont venus s’investir en Chine après l’ouverture lancée par le « camarade » Deng au début des années 1980, en transformant la Chine en nouvel « atelier du monde », jamais cette dernière n’aurait pu en quelques décennies se mettre à tailler des croupières à « l’Occident global ». Et ce même si, simultanément, les politiques de développement lancées par le PCC y ont pris leur part, en synergie avec ces mouvements de capitaux « occidentaux » ou en les instrumentalisant dans le cadre de joint ventures. Donc, derrière l’émergence des « émergents », il y a la transnationalisation d’une partie du capital « occidental ». Et il convient de ne pas perdre cela de vue, parce que le jeu de ces derniers (leurs intérêts, leurs stratégies, leurs projets à long terme) ne se confondent pas plus avec ceux de leurs actuels Etats hôtes (les « émergents ») qu’ils ne sont confondus avec ceux de leur anciens (et pour la plupart toujours actuels) Etats d’origine « occidentaux ».
D’autre part, les BRICS+ sont encore très loin de constituer un bloc homogène, du fait notamment des concurrences, rivalités et même conflits qui peuvent exister ou pourraient se développer entre certains d’entre eux, notamment du fait de la prédominance croissante de la Chine parmi eux. Certes, il est possible que, précisément du fait de sa prédominance, la Chine parvienne à hégémoniser sous sa direction en un bloc ces différents États, mais cela n’a nullement gagné d’avance.
Quoi qu’il en soit, l’émergence de ces Etats manifeste que, loin d’être un long fleuve tranquille dont le cours nous ferait sortir de l’histoire, la « mondialisation » capitaliste tend à accoucher d’un monde multipolaire, par définition instable et plein de risques d’affrontement. Elle manifeste clairement un déclin relatif de « l’Occident global » et tout particulièrement des Etats-Unis qui, s’ils restent la principale puissance mondiale, n’ont plus les moyens d’exercer leur hégémonie (dans son sens gramscien) au sein de ce monde. Plus largement, sur fond de « la stagnation séculaire » dans laquelle semble engagée l’économie « occidentale », elle exacerbe les rivalités pour l’accès aux ressources stratégiques (combustibles fossiles, métaux, terres rares, etc.) et elle favorise le repli sur soi des Etats, dont la guerre commerciale qu’initient actuellement les Etats-Unis est la manifestation la plus évidente.
Cette situation présente un risque spécifique pour les organisations d’extrême gauche : celui du campisme. Les ennemis de nos ennemis n’étant pas nécessairement des amis ni même des alliés, il faut se garder d’épouser la cause de ceux qui sont aujourd’hui ou pourraient être demain capables de mettre en échec la prédominance du « camp occidental » dans la conduite des affaires mondiales. En particulier, aucun des « Etats émergents » ne constitue en rien un modèle de démocratie politique et encore moins de démocratie sociale, loin de là même le plus souvent. Sous ce rapport, leur émergence signe au contraire la prévalence grandissante de régimes qui tournent le dos aux exigences minimales de l’émancipation sociale. Et il convient par conséquent de continuer à les dénoncer comme tels.
5. La montée en puissance des Gafam
Cette montée en puissance s’illustre tout d’abord par le fait que ces entreprises états-uniennes du secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) font partie des toutes premières capitalisations boursières mondiales au terme d’à peine plus d’une vingtaine d’années d’existence pour certaines d’entre elles. Leur force de frappe financière leur permet de constituer un étroit oligopole dans leur secteur, que peinent à concurrencer leurs homologues et rivales chinoises (Huawei, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi), russes (Yandex, Mail.Ru et VKontakte) ou coréennes (Samsung, Coupang, Naver et Kakao). Elles maintiennent leur suprématie par leurs constantes innovations techniques et commerciales.
Colonisant déjà une grande partie de la communication électronique, depuis la messagerie jusqu’au commerce en ligne, elles sont soupçonnées de jeter les bases d’une future société dystopique de surveillance généralisée[4]. Aussi leur récent ralliement à Trump, alors qu’elles ont été longtemps des soutiens importants du Parti démocrate, et le fait qu’elles aient immédiatement obtenu de lui qu’il lève un certain nombre de restriction dans le développement de l’IA précédemment apposées par l’administration Biden et qu’il fasse pression sur l’Union européenne pour obtenir des mesures identiques, on fait dire à certains que nous assisterions à une prise du pouvoir des Gafam aux Etats-Unis, préfigurant un pareil scénario en Europe. Un scénario qui verrait le capital se saisir de et exercer directement le pouvoir politique sans les traditionnels médiations gouvernementales. Une thèse notamment soutenue par Cédric Durand pronostiquant l’avènement d’un techno-féodalisme[5].
Pour préciser les termes du débat, rappelons que, selon l’analyse marxiste classique, la séparation entre l’économique et le politique (entre la société civile et l’Etat) est structurelle au sein du capitalisme, contrairement par exemple à ce qui se passait dans le féodalisme. La raison fondamentale en est la propriété privée des moyens sociaux de production qui définit le capital comme rapport social de production. Cette forme de propriété fait que la prise en compte et en charge de l’intérêt général de la classe capitaliste, traversée par des oppositions, des rivalités et même des conflits d’intérêt, non seulement entre les multiples capitalistes individuels mais entre les différents fractions fonctionnelles (capital industriel, capital commercial, capital bancaire, etc.) et territoriales (régionales, nationales, continentales) du capital, ne peut être que le fait d’une instance formellement séparée et indépendante de la classe capitaliste sous la forme d’un Etat. Et cette nécessité est redoublée par l’exigence de prendre également en compte et en charge les intérêts des autres classes sociales, par définition dominées à différents degrés et sous différentes formes, même si (et précisément parce que) cette prise en compte et en charge doit se faire sous condition de leur subordination aux intérêts capitalistes. Cela explique notamment que la classe (ou fraction ou couche) régnante (celle dont sont issues les personnes exerçant habituellement le pouvoir d’Etat : les fonctions gouvernementales) ou la classe (ou fraction ou couche) tenante (celle qui fournit majoritairement le haut personnel des différents ou principaux appareils d’Etat : armée, police, justice, appareil fiscal, appareil de gestion économique, administration, etc.) puissent ne pas être la classe dominante et que c’est même ordinairement le cas.
En principe, cette séparation ne peut pas être remise structurellement en question. Si elle est l’est conjoncturellement, c’est nécessairement au prix d’une exacerbation des conflits non seulement entre les différentes parties de la classe dominante, soit au prix d’une incohérence croissante de la gestion des intérêts généraux de celle-ci, mais encore entre cette classe et les autres classes, ce qui ne fait qu’accroître le caractère chaotique de la sphère politique, conduisant à terme à une crise de la gouvernementalité de l’Etat, voire de l’Etat lui-même, débouchant sur une normalisation par retour à la situation de séparation… ou sur une rupture révolutionnaire.
Je ne pense donc pas que le récent ralliement des Gafam à Trump, pas plus que toute autre opération du même type, nous fasse sortir de la situation de séparation précédemment décrite. Les facilités qui leur ont été accordées par Trump correspondent ni plus ni moins à ce que tout segment du capital concentré et centralisé (le « grand capital ») ait en mesure d’obtenir régulièrement de toute administration dans un Etat capitaliste, dans la limite cependant de ses positions au sein du bloc au pouvoir, c’est-à-dire du système d’alliances qui exerce le pouvoir d’Etat, donc de l’équilibre dans les rapports de force entre classes, fractions de classe et couches sociales composant ce bloc. Tout juste convient-il par conséquent de se demander à quelles modifications de cet équilibre correspond le ralliement des Gafam à Trump ou sur quelles modifications ce dernier est susceptible de déboucher.
6. Le développement de l’intelligence artificielle
Ce point complète le précédent. La spécificité de l’intelligence artificielle (IA) et les problèmes que soulève son développement méritent cependant qu’on lui accorde une attention particulière, justifiant un développement autonomie à son sujet.
La notion d’IA reste floue et controversée. Elle recouvre en fait différents développements reposant sur le traitement automatique de grandes masses de données. Je l’entends ici au sens des procédés algorithmiques reposant sur la constitution d’une masse aussi étendue que possible d’informations (au sens de données, les fameux big data) et sur leur exploitation statistique visant à déterminer des corrélations inconnues existant entre elles, le tout dans le but de parvenir à des profilages de ces données susceptibles de permettre des prédictions ou d’éclairer un processus décisionnel. A ce titre, deux types d’applications demandent à être suivis de près.
Le premier concerne tout ce qui relève de la gouvernementalité algorithmique, que ce soit dans l’espace public ou dans des organisations privées, dont est attendue un gain d’efficacité dans la surveillance des comportements individuels et dans la prévision et la prévention de ceux d’entre eux jugés déviants. C’est la mise en œuvre de ce type d’applications de l’IA qui renforce la crainte de la réalisation de la dystopie orwellienne.
Le second consiste dans l’automatisation partielle ou totale de travaux supposant la mémorisation et le traitement (analyse et synthèse) d’un grand nombre de données, dont sont attendues des gains de productivité qui se traduiraient automatiquement, dans un contexte capitaliste, par des licenciements collectifs mais aussi par une déqualification des forces de travail employées résiduelles. Ce qui serait susceptible d’affecter des secteurs (par exemple les administrations publiques) ou des professions (par exemple les professions intellectuelles, qu’elles soient actuellement exercées sous une forme salariée ou sous une forme libérale) qui avaient jusqu’à présent échappés en tout ou partie à l’emprise directe du capital.
Il est trop tôt pour se prononcer sur la mise en œuvre effective de telles applications et sur leurs résultats. Tout ce qu’on peut en dire pour l’instant est que, d’une part, elles viendraient après plusieurs vagues antérieures d’informatisation, ce qui en relativise la nouveauté ; et que, d’autre part, ces mêmes vagues antérieures s’étaient déjà accompagnées de la promesse de gains prodigieux en efficacité et en productivité qui ne se sont au mieux que partiellement produits. Ce qui incite une nouvelle fois à la prudence dans l’évaluation de la portée disruptive de ces applications promise par leurs promoteurs, au rebours de tous les essais qui y voient au contraire l’avènement d’une nouvelle ère du capitalisme bouleversement toutes les structures antérieures et les catégories en permettant l’intelligibilité[6].
Alain Bihr
[1] Cf. « Le fascisme ne passera plus », Réfractions, n°34, printemps 2015. Repris sous le titre « Le capitalisme n’est pas le seul régime d’état d’exception auquel un capitalisme en crise puisse donner naissance » sur le site Alencontre www.alencontre.org/ le 20 octobre 2015. Et « Le fascisme est-il d’actualité ? », L’Anticapitaliste, https://lanticapitaliste.org/actualite/societe/le-fascisme-est-il-dactualite mis en ligne le 10 mars 2021.
[2] Cf. La novlangue néolibérale. La rhétorique du fétichisme capitaliste, Page 2 & Syllepse, Lausanne & Paris, 2017.
[3] Cf. Richard Hofstadter, Le style paranoïaque. Théories du complot et droite radicale en Amérique [1965], Paris, François Bourin Editeur, 2012.
[4] Cf. Shoshana Zuboff, L’âge du capitalisme de surveillance, Honfleur, Zulma, 2020.
[5] Cf. Cédric Durand, Techno-féodalisme. Critique de l’économie numérique, Paris, La Découverte, 2020.
[6] Cf. par exemple Jonathan Durand Folco et Jonathan Martineau, Le capital algorithmique. Accumulation, pouvoir et résistance à l’ère de l’intelligence artificielle, Montréal, Ecosociété, 2023.



A lire également
Le rendez-vous à ne pas manquer
NOUVEAU MONDE? NOUVEAUX DÉFIS
Le capitalisme et la révolution numérique