Pour la doxa
progressiste, reprise avec zèle par
la tradition marxiste (malgré le premier vers de l’Internationale), la démocratie moderne est urbaine. Opposé au
citadin-citoyen, le paysan serait au
mieux arriéré, au pire réactionnaire (et la
paysanne inexistante).
Face à cette caricature, surgit un étonnant
cortège d’expériences agri culturelles :
du jardin d’Éden à la « petite république » que fut la ferme pour Jefferson,
des tenures et communaux féodaux au lopin russe, du jardin ouvrier ou
thérapeutique aux « guérillas vertes »
et jardins partagés, se pourrait-il que les relations des cultivateurs à
la terre favorise l’essor des valeurs démocratiques et la citoyenneté ?
Jardiner la terre c’est dialoguer, être attentif, expérimenter, et
apprendre des autres, coopérer, partager.
Et si, « En raison des méfaits de l’agriculture « conventionnelle », qui en devenant industrielle, productiviste et intensive a cessé de produire les environnements dont à la fois les humains et la terre dépendent pour leur renouvellement réciproque, les paysans retrouv(ai)ent dans l’urgence leur mission première, celle de faire de la planète une « terre des hommes » et de prendre soin de la terre qui leur est commune » ?
Fred Bouviolle
Joëlle ZASK, La démocratie aux champs, La Découverte (2016), 236 p., 18,5 €

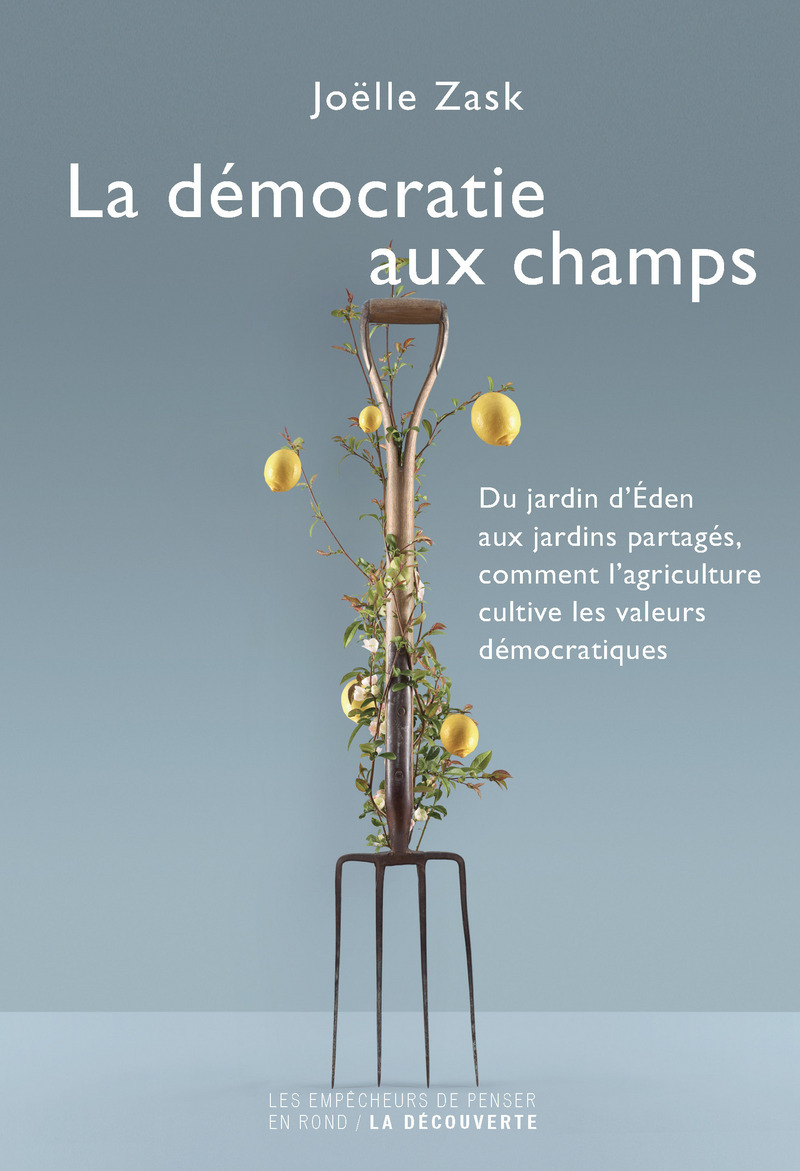
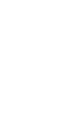
A lire également
Les invisibles
« Retour à Heillange »
Monsieur