Frantz Fanon, médecin-psychiatre, écrivain, penseur audacieux, théoricien de la colonialité, combattant anti-colonialiste fervent, a marqué le XXe siècle par l’audace de sa pensée et de son action.
Frantz Fanon né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, Martinique, est le 5e des huit enfants d’une famille mulâtre. Au lycée Schoelcher, Aimé Césaire fut l’un de ses enseignants.
Psychiatre, essayiste, militant anticolonialiste, Frantz Fanon se considère citoyen algérien, s’investit considérablement dans le combat d’indépendance de l’Algérie, prenant part au mouvement international construisant la solidarité aux frères opprimés.
Il est désormais acquis que Frantz Fanon a fondé les notions de Tiers-monde et d’anti-colonialité. A ses compagnons antillais arguant d’une guerre d’Algérie concernant les seuls Blancs, il rétorque : « Chaque fois que la dignité et la liberté de l’homme sont en question, nous sommes concernés, Blancs, Noirs ou Jaunes, et chaque fois qu’elles seront menacées en quelque lieu que ce soit, je m’engagerai sans retour »
De la guerre, Fanon dira la discrimination infligée aux soldats africains. A Fanon, descendant d’esclaves, la France avait inculqué le patriotisme tricolore, ayant néanmoins tissé aux Antilles un complexe de supériorité quant aux Africains. Et par là-même, la détestation d’une part de soi.
Fanon, étudiant en médecine à Lyon, s’inscrit aussi en philosophie et psychiatrie, afin d’appréhender les processus complexes de la colonisation et de désubjectivation du colonisé. Affrontant le racisme au quotidien, il publie sa thèse de doctorat en psychiatrie en 1952 sous le titre « Peau noire, masques blancs ». Elle dénonce la citoyenneté de façade imposée par la politique assimilationniste, grandement intériorisée par la conscience antillaise.
1953, Fanon dirige l’Hôpital psychiatrique de Blida, (Algérie), soignant de jour les soldats métropolitains blessés, de nuit, les victimes de l’oppression coloniale. 1956, sa lettre de démission souligne le lien entre psychose et aliénation colonialiste. La Guerre d’Algérie a déjà deux ans.
Expulsé d’Algérie en 1957, Fanon s’installe à Tunis, rejoignant le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne, devenant membre de la rédaction d’El Moudjahid, organe majeur du FLN (Front de Libération Nationale). En 1959, il fait partie de la délégation algérienne au Congrès pan-africain d’Accra (Ghana). En mars 1960, il est nommé ambassadeur de l’Algérie au Ghana. Il publie L’An V de la révolution algérienne en 1959 et Les Damnés de la terre en 1961.
Fanon meurt de leucémie aiguë à Washington le 6 décembre 1961. Il est inhumé au cimetière de Chouhadas, toponyme signifiant « les martyrs de la guerre », à quelques mois de l’Indépendance.
Frantz Fanon est aujourd’hui reconnu fondateur, pionnier et passeur majeur des désormais nommées « études postcoloniales ». Traductions et travaux relatifs à ses essais sont nombreux. Son ouvrage Les Damnés de la terre est perçu comme livre essentiel dans le tiers monde de langue française.
Catherine Destom-Bottin
Essais:
Peau noire, masques blancs. Paris: Seuil, 1952; 1995.
L’An V de la révolution algérienne. Paris: François Maspero, 1959. (Réédité chez Maspero en 1968 sous le titre « Sociologie d’une révolution ».) En version fac-similé: Paris: La Découverte, 2001.
Les Damnés de la terre. (préface de Jean-Paul Sartre) Paris: François Maspero, 1961; Paris: Présence Africaine, 1963; Paris: Gallimard, 1991; Paris: La Découverte, 2002.
Pour la révolution africaine; écrits politiques. Paris: François Maspero, 1964; Paris: La Découverte, 2006.

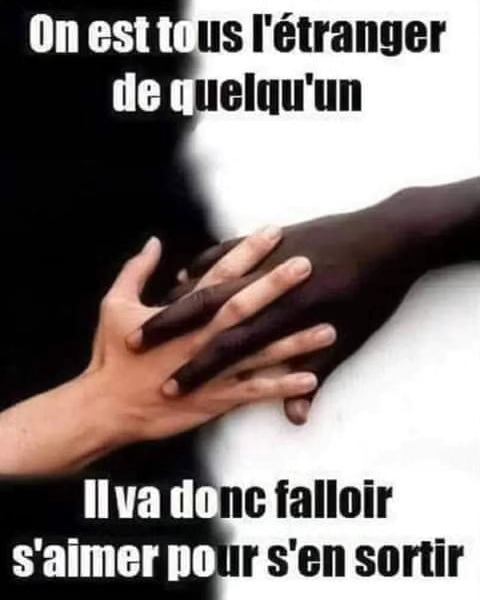

A lire également
2019, du neuf !
14 Juillet, l’Ordre du jour, la Guerre des pauvres :
Éloge et condamnation des murs