La crise du capitalisme mondial, dont les manifestations sont multiples, de l’économique au social et à l’écologique, sans même parler des chocs comme la pandémie du coronavirus et la guerre déclenchée par Poutine en Ukraine, aggravant brutalement les tensions inflationnistes, apporte au moins une bonne nouvelle : on reparle du travail. Et on en reparle autrement qu’à travers les nombreuses apories qui ont pu être énoncées dans les trente dernières années : la fin du travail, la disparition de la valeur(-)travail[1], la disparition des classes sociales et surtout de la classe ouvrière, etc. On reparle du travail dans un tout autre registre : le travail est essentiel. À cet égard, les confinements dus au Covid-19 ont été marquants : miraculeusement on a redécouvert les « travaux essentiels » accomplis par les « premiers de corvée », au sein desquels il y a beaucoup de femmes, pour le maintien de la société. Bien entendu, le cynisme des classes dominantes est apparu sans fard : ceux-là mêmes qui s’étaient ingéniés à dévaloriser le travail, et surtout celui qui est essentiel, ont, la main sur le cœur, fait assaut de promesses en sa faveur, vite oubliées ensuite.
C’est dans ce contexte que deux chercheurs en sciences sociales, Thomas Coutrot et Coralie Perez, publient en ce début d’automne Redonner du sens au travail, Une aspiration révolutionnaire (Seuil, La République des idées, 2022). Tous deux spécialistes du travail, ils ont mené un grand nombre d’enquêtes de terrain, souvent publiées dans les documents de la DARES (direction d’études du Ministère du travail), et ils rassemblent dans cet ouvrage les matériaux les plus importants de leurs enquêtes, à partir de leur hypothèse que « le travail joue un rôle central dans nos vies » (p. 15).
Redonner du sens
D’emblée, les auteurs indiquent que, malgré la dégradation des conditions de travail et la perte de sens du travail lui-même, les aspirations des travailleurs à lui en redonner un sont de plus en plus nombreuses. Et cela se manifeste de plusieurs manières : en premier lieu par des résistances, et par un phénomène aujourd’hui en recrudescence : les démissions, en grand nombre aux États-Unis, mais aussi en Europe et en France. L’originalité de Coutrot et Perez est de soutenir que le refus n’est pas celui du travail en soi mais celui du « travail insensé, un travail mutilé de son potentiel d’émancipation par le management financiarisé» (p. 15). Ils décèlent trois dimensions des enjeux du sens du travail : « l’impact du travail sur le monde (l’utilité sociale), les normes de la vie en commun (la cohérence éthique) et le travailleur lui-même (la capacité de développement) » (p. 13).
Pour saisir l’importance de ces enjeux, et notamment le fait que quoiqu’importants soient le salaire et les conditions dans lesquelles on travaille, il faut bien distinguer le travail et l’emploi : « L’emploi, c’est l’institution qui encadre l’exercice du travail, pas le travail lui-même ». Ce qui fait la spécificité du travail, c’est qu’il est « une activité par laquelle la personne engage son corps et son esprit dans l’acte de produire, en mobilisant son savoir-faire, sa dextérité, son intelligence, sa créativité, etc. » (p. 16-17). Comme le disait Marx, « en agissant sur la nature extérieure et en la modifiant par ce mouvement, il modifie sa propre nature. Il développe les potentialités qui y sont en sommeil. » (p. 18).
Ainsi que l’ont montré les sociologues, les ergonomes et les psychodynamiciens du travail, « travailler, c’est combler l’écart entre le prescrit et le réalisé ». Et c’est précisément dans cet écart que gît la potentialité d’émancipation du travail. Les auteurs citent Christophe Dejours pour qui « Le “réel” auquel se heurte la personne au travail n’est pas seulement le réel du “monde objectif” (la matière, les contraintes techniques, etc.) ; c’est aussi celui du “monde social”, “un monde hiérarchisé, ordonné et contraint, traversé par la lutte contre la domination”. » (p. 19). Même dans un monde soumis à la loi des actionnaires, « les managers sont contraints de reconnaître que le travail ne peut être réduit à une série de consignes et de gestes prédéfinis : il est nécessairement un travail concret, une production de valeur d’usage dans un contexte toujours particulier où le réel existe. Le travail vivant est ce qui, dans l’activité de travail, échappe toujours à la conception abstraite et routinière à laquelle l’organisation capitaliste cherche à réduire le travail. » (p. 44). C’est donc « au cœur de l’activité de travail [que] se loge un pouvoir d’agir qui, en dépit des tentatives répétées du management, n’est pas entièrement éliminable. » (p. 44).
En correspondance avec les trois enjeux ci-dessus, le concept de « sens du travail » revêt trois dimensions : la première est « la finalité à atteindre dans le monde objectif » ; la deuxième correspond « aux valeurs dans le monde social » ; la troisième se rapporte « à l’accomplissement et à la transformation de soi » (p. 20).
Les enquêtes menées par les auteurs montrent que ces dimensions ne sont pas perçues également selon les catégories socio-professionnelles, mais on aurait tort de croire que seules les personnes qualifiées ou occupant des positions d’encadrement ou riches y sont sensibles. Beaucoup de facteurs jouent : notamment le travail du soin (le care) ou de l’éducation, et la présence d’une représentation syndicale et collective du personnel. C’est ainsi que « les métiers qui ont gagné en sentiment d’utilité travaillent tous au contact du public, sans pouvoir télétravailler (sauf dans les expériences mitigées des enseignant.es pendant les confinements) » (p. 32-33).
Dépasser les obstacles
Leur problématique étant ainsi posée, Coutrot et Perez examinent d’une part les obstacles devant la définition d’un sens au travail, et d’autre part les tentatives pour les dépasser.
Ils consacrent un chapitre à analyser les dégâts causés par « le management par le chiffre » (p. 47 et suiv.). Ce type de gestion de la main-d’œuvre s’est imposé avec la financiarisation de l’économie et a vite éliminé les tentatives d’enrichissement des tâches : un « toyotisme dévoyé » et un « mangement désincarné » ont touché aussi bien l’industrie que le commerce et beaucoup d’autres services. On retrouve les exigences de valorisation du capital dans la volonté de changer tout « tout le temps » (p. 55) et d’exiger toujours plus des sous-traitants.
La perte de sens du travail se situe également dans la dégradation écologique dès lors qu’est assignée aux travailleurs la tâche de « travailler contre la nature » (p. 63 et suiv.). Longtemps opposés, les objectifs sociaux et écologiques deviennent heureusement de plus en plus entremêlés, sinon rendus cohérents encore. Ainsi, surgissent fréquemment des préoccupations comme « quand mon travail nuit à l’environnement » (p. 65) ou bien un « remords écologique » qui se manifeste par un questionnement sur « qui fait le “sale boulot” ? » (p. 66-67). Les auteurs montrent le lien existant entre ce sale boulot et les tâches pour lesquelles les travailleurs ont peu d’autonomie « sans marge de manœuvre » (p. 68). Mais ce souci gagne maintenant les travailleurs en « col blanc ». Couvrir un « travail insoutenable » et des « opérations de greenwashing » (p. 71) devient plus difficile.
S’ouvre alors la possibilité d’un « environnementalisme du travail » (p. 73) éloigné du productivisme auquel la gauche et les syndicats se sont longtemps ralliés, à rebours de la thèse de Marx pour qui l’accumulation du capital étaient synonyme de l’exploitation conjointe du travail et de la nature[2].
Les auteurs se penchent sur les réponses apportées par les managers un peu conscients « des systèmes de travail peu soutenables » (p. 79). Face à la corporate governance soucieuse uniquement de rendement financier, a émergé l’idée d’une « responsabilité sociale de l’entreprise » (RSE), dite aussi Triple Botton Line (TBL),ou Triple P (pour People, Planet, Profit) » (p. 80). Une grande imagination se manifeste pour mesurer cette responsabilité au sein de cabinets d’experts en « ESG, Environment, Social and Governance » (p. 81), mais ceux-ci donnent des résultats pour le moins peu convaincants. À preuve, les scandales Volkswagen, Orpea, etc. Aussi, la RSE ne redonne guère de sens au travail, on cherche en vain la finance responsable, et « la gouvernance partagée » ou la « codétermination » ne semblent pas « améliorer la soutenabilité écologique de la production, ni réduire le potentiel de conflits éthiques environnementaux » (p. 90-91).
Pourtant, « l’histoire du management est jalonnée de tentatives visant à “humaniser le travail” » (p. 95). L’« entreprise libérée » (p. 96) en fait partie. Mais il s’agit d’une libération « octroyée et réversible » (p. 99), en contrepartie d’une intensification du travail. On est loin d’une émancipation du travail quand les entreprises dites libérées « visent plutôt à relégitimer l’autorité capitaliste en réservant sa mise en œuvre aux décisions stratégiques, tout en déléguant les décisions secondaires aux salarié.es. » (p. 103). C’est dire que « le rapport salarial de subordination, qui confère aux détenteurs du capital le monopole des décisions stratégiques, se révèle incompatible avec un véritable autogouvernement du travail. Pour autant, et ce n’est pas négligeable, les expérimentations du management humaniste recherchent et trouvent parfois des formes de contrôle du travail moins pathogènes, plus épanouissantes, et qui font donc plus sens pour les salarié.es. » (p. 104).
Il faut donc se tourner, écrivent Coutrot et Perez, vers « les initiatives venues d’”en bas” » (p. 105). Des syndicalistes se penchent « au chevet du travail » (p. 118). Que ce soit au sein de la FSU, de Solidaires, de la CFDT et de la CGT, « la question du travail commence à être au cœur de la démarche revendicative », pour « conquérir “de nouveaux droits sociaux dans la gestion des entreprises, afin de peser sur le sens du travail, le contenu et la finalité de la production, les conditions de travail et son organisation” », (p. 118), comme le dit la CGT.
Les auteurs mentionnent évidemment l’expérience des coopératives et situent « l’essor de l’économie des communs » (p. 125) comme révélatrice de l’aspiration à l’autogouvernement.
Quelques questions
Les auteurs esquissent pour terminer l’idée que partir du travail ou y rester seraient des réponses complémentaires. « Ne peut-on considérer que fuite individuelle, résistance collective et engagement dans des alternatives sont des réponses complémentaires à la perte du sens du travail ? On pourrait faire l’hypothèse qu’en démissionnant, les salarié.es qui partent renforcent le pouvoir d’agir de celles et ceux qui restent : les managers ne doivent-ils pas mieux les traiter pour espérer les garder ? » (p. 130). Coutrot et Perez posent la question, mais la réponse est fragile, parce qu’il s’agit de savoir si les départs individuels du champ social facilitent la formation de projets collectifs. À une époque où se sont disloqués beaucoup de tissus collectifs, notamment dans les espaces de travail, ce n’est pas très sûr.
Le livre de Thomas Coutrot et Coralie Perez arrive à un bon moment, celui où les transformations du capitalisme et ses contradictions suscitent des questions et des engagements sur le sens du travail, dont la manifestation la plus visible a été au cours des dernières années ce qui est nommé dans les medias « la grande démission », le quiet quitting, big quiet ou great resignation. Mais, curieusement, les auteurs ne donnent pas beaucoup d’indications chiffrées précises sur l’ampleur de cette vague de démissions. Peut-on parler d’un raz-de-marée ou plutôt d’une accélération d’une tendance ancienne à cause des chocs subis par la plupart des pays ? On note 4 à 5 millions de retraits aux États-Unis, ce qui représente à peine un peu plus de 3 % de la population active. En France, le nombre a fortement augmenté ces derniers mois, mais il est à peine plus élevé qu’il l’était avant la crise de 2007-2008, selon une étude de la DARES elle-même.

Deux autres questions pourraient être posées à Coutrot et Perez. L’une peut être formulée ainsi : est-il absolument aussi certain qu’ils l’affirment que les syndicats et le mouvement ouvrier se soient en presque deux siècles de résistances aussi peu intéressés au sens du travail pour s’abandonner aux délices du productivisme permis par une quête de salaires toujours plus hauts ? Cette thèse univoque, postulant une homogénéité de toutes les luttes, est intenable et on pourrait citer mille exemples de luttes où la revendication immédiate n’était jamais totalement séparée des conditions d’exercice du travail ; en un mot, des luttes de classes qui mettaient en cause la subordination subie et aspiraient à une démocratie meilleure. Certes, on pourrait en citer tout autant où, acculés par la menace de licenciements ou la violence patronale, les travailleurs en position défensive n’étaient pas en mesure de (disposant de la force pour) faire « valoir » en tout son sens leur travail.
Faire « valoir » : l’autre question colle précisément avec l’actualité qui nous donne à voir un débat totalement biaisé et donc piégé. Qu’en est-il de ladite valeur(-)travail ? Du côté de l’idéologie libérale et conservatrice, domine la thèse selon laquelle la protection sociale, dont le volet assurance chômage, aurait toujours été un encouragement à ne pas travailler et donc nierait la valeur morale du travail. Par un mélange curieux d’éthique luthérienne, faisant du travail le moyen de profiter et de se réaliser, et d’idéologie calviniste, voyant dans le succès obtenu en travaillant un signe de la prédestination divine, la droite conservatrice n’en finit jamais d’exiger de travailler toujours davantage tout en dégradant ceux qui s’y adonnent. Du côté de la gauche social-démocrate ayant viré au social-libéralisme pour ne pas dire au néolibéralisme, les sirènes en faveur de la fin du travail, du revenu d’existence en lieu et place de vrais salaires et de l’objectif de plein emploi, ont créé un vide théorique et jeté de larges fractions des couches populaires dans les bras de l’extrême droite. Aussi, on pourrait demander à Coutrot et Perez pourquoi ils ne relient pas le sens du travail pour lequel lui et elle militent à la dualité du concept de travail vivant. Le travail est vivant dans le sens où nos auteurs le développent avec force : il transforme la matière et, par lui, le travailleur se produit lui-même ; ainsi peut-on comprendre que le travail représente une valeur philosophiquement, éthiquement et politiquement. Mais le travail est également vivant parce qu’il crée la valeur économique en transformant le capital qui est mort. Or, dans le débat public, la plupart des locuteurs confondent la « valeur travail » dans la première acception ci-dessus et la « valeur-travail » dans la seconde acception, du nom de la théorie venant de l’économie politique et parachevée par Marx pour désigner l’origine de la valeur économique des marchandises, tout en forgeant le concept de force de travail pour dire que la « valeur du travail » n’avait aucun sens économique[3]. L’hypocrisie de l’affaire est que l’idéologie dominante nie la « valeur-travail » pour magnifier la « valeur travail » tout en dégradant le travail. Le cocasse, sinon la désolation, est que la gauche traditionnelle s’est emmêlé les pieds en perdant tous les sens du travail vivant et en oubliant donc ses finalités.
C’est la raison pour laquelle il faut saluer l’ouvrage de Thomas Coutrot et Coralie Perez. Nous sommes à un tournant qu’il ne faut pas rater : crise sociale et crise écologique s’entrechoquent. Ils ont donc raison de plaider pour une articulation inédite entre un travail redéfini avec du sens, son insertion soutenable dans notre planète et un approfondissement radical de la démocratie. Il restera à construire des collaborations et des synergies avec tous les chercheurs qui argumentent dans la même direction, le même sens donc, pour réhabiliter le travail et l’inscrire dans une problématique sociale et écologique[4].
[1] Valeur(-)travail avec ou sans trait d’union comme on le verra plus loin.
[2] Les auteurs citent le courant actuel du « marxisme écologique ». Pour une présentation de ce courant, voir notamment : John Bellamy Foster, Marx écologiste, Amsterdam, 2011 ; Michaël Löwy, Qu’est-ce que l’écosocialisme ?, Le Temps des cerises, 2020 ; Jean-Marie Harribey, Le trou noir du capitalisme, Pour ne pas y être aspiré, réhabiliter le travail, instituer les communs et socialiser la monnaie, Le Bord de l’eau, 2020 ; En finir avec le capitalovirus, L’alternative est possible, Dunod, 2021.
[3] Sur ces points controversés, voir Jean-Marie Harribey, La richesse, la valeur et l’inestimable, Fondements d’une critique socio-écologique de l’économie capitaliste, Les Liens qui libèrent, 2013. Et sur mon blog aussi, en raccourci : « Travail : détournement de fonds et de fond », 15 novembre 2021.
[4] La réflexion se situant dans le sillage de celle de Marx sur le travail vivant n’a jamais disparu, voir par exemple : Jean-Louis Bertocchi, Marx et le sens du travail, Éditions sociales, 1996 ; sans parler des propres travaux de Thomas Coutrot très nombreux depuis Critique de l’organisation du travail, La Découverte, Repères, 1999, jusqu’à Libérer le travail, Pourquoi la gauche s’en moque et pourquoi ça doit changer, Seuil, 2018 ; et, pour allier travail et écologie, Jean-Marie Harribey, L’économie économie, Le développement soutenable par la réduction du temps de travail, L’Harmattan, 1997 ; Le trou noir du capitalisme, Pour ne pas y être aspiré, réhabiliter le travail, instituer les communs et socialiser la monnaie, op. cit. ; En finir avec le capitalovirus, L’alternative est possible, op. cit.
Thomas Coutrot et Coralie Perez : Redonner du sens au travail, Une aspiration révolutionnaire (Seuil, La République des idées, 2022) 160 pages 13.50 € TTC

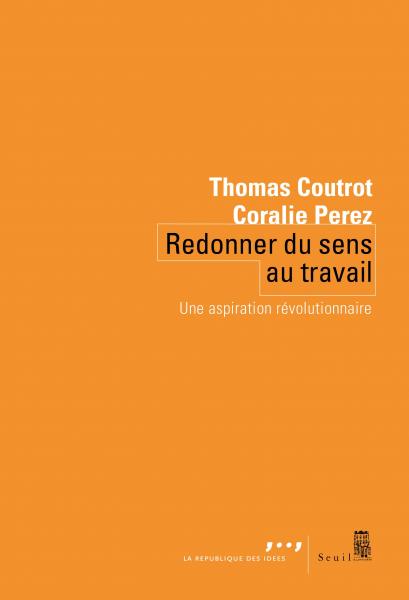

A lire également
Les invisibles
« Retour à Heillange »
Monsieur