« Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m’entourent, hommes ou femmes, sont également libres. La liberté d’autrui, loin d’être une limite ou une négation de ma liberté, en est au contraire la condition nécessaire et la confirmation. Je ne deviens vraiment libre que par la liberté des autres, de sorte que, plus nombreux sont les hommes libres qui m’entourent, et plus étendue et plus large est leur liberté, plus étendue et plus profonde devient la mienne. C’est au contraire l’esclavage des autres qui pose une barrière à ma liberté, ou, ce qui revient au même, c’est leur bestialité qui est une négation de mon humanité parce que, encore une fois, je ne puis me dire libre vraiment que lorsque ma liberté, ou ce qui veut dire la même chose, lorsque ma dignité d’homme, mon droit humain, qui consiste à n’obéir à aucun homme et à ne déterminer mes actes que conformément à mes convictions propres, réfléchit par la conscience également libre de tous, me reviennent confirmés par l’assentiment de tout le monde. Ma liberté personnelle ainsi confirmée par la liberté de tous s’étend à l’infini.[1] ».
Une fois n’est pas coutume, ce texte commence par une citation d’un des penseurs de l’émancipation sociale ; non par fétichisme, pas de « bakouninisme », mais parce qu’il n’est pas utile de réécrire plus mal ce qui l’a déjà été fort bien. Le « je » et les « nous » sont ici clairement évoqués, sous l’angle du rapport dialectique entre libertés individuelles, libertés de tous et toutes, libertés collectives. Il n’y a pas grand-chose à ajouter à ce texte du 19ème siècle, si ce n’est la nécessité tout de même de creuser les contours de la liberté individuelle venant fortifier la liberté de tous et toutes. Par exemple, en cas d’épidémie, la liberté individuelle de ne pas se vacciner renforce-t-elle vraiment la liberté de tous et toutes à combattre le virus ? Sans vouloir faire de Bakounine un pro-vaccin, ne peut-on penser que cet exemple s’insère dans ce qu’il vise par « ne déterminer mes actes que conformément à mes convictions propres » mais « réfléchit par la conscience également libre de tous, […] confirmés par l’assentiment de tout le monde. » ?
La mise en avant du « je » est, en partie, une réponse à sa négation par un « nous » trop souvent anonyme et outil de domination sur les « je ». Aujourd’hui, le courant abusivement qualifié de libertarien (quel rapport avec la liberté ou le courant libertaire ?) prétend incarner cette aspiration à la liberté individuelle. Mais c’est la liberté de chacun et chacune d’espérer exploiter et dominer les autres, l’opposé du souci d’émancipation sociale, individuelle et collective !
Pour autant, nous ne devons pas ignorer cette aspiration des « je » à exister, y compris au sein de nos collectifs militants, où le « nous » a souvent servi, là aussi, à aliéner les « je ». C’est une nécessité, si nous voulons nous situer dans une perspective émancipatrice autogestionnaire, égalitaire. Mais le « je » de chacun et chacune ne doit pas devenir ce qui détermine l’action collective. Les « je » contribuent à l’élaboration collective, ils n’en sont pas l’alpha et l’oméga. C’est le rapport dialectique, parfois la contradiction, entre les « je » et le « nous » qui permet d’avancer.
Christian Mahieux
[1] Michel Bakounine, Dieu et l’Etat, 1882. Le texte est repris dans Arthur Lehning, Archives Bakounine, volume 7, L’Empire knouto-germanique et la révolution sociale, E.J. Brill, Leyde, 1982. Réimpression aux éditions Champ libre en 1982, puis aux éditions Tops/Trinquier en 2003. Il est aussi disponible sous forme de brochure, en de très nombreuses langues.
Image : ©https://mencoboni.com

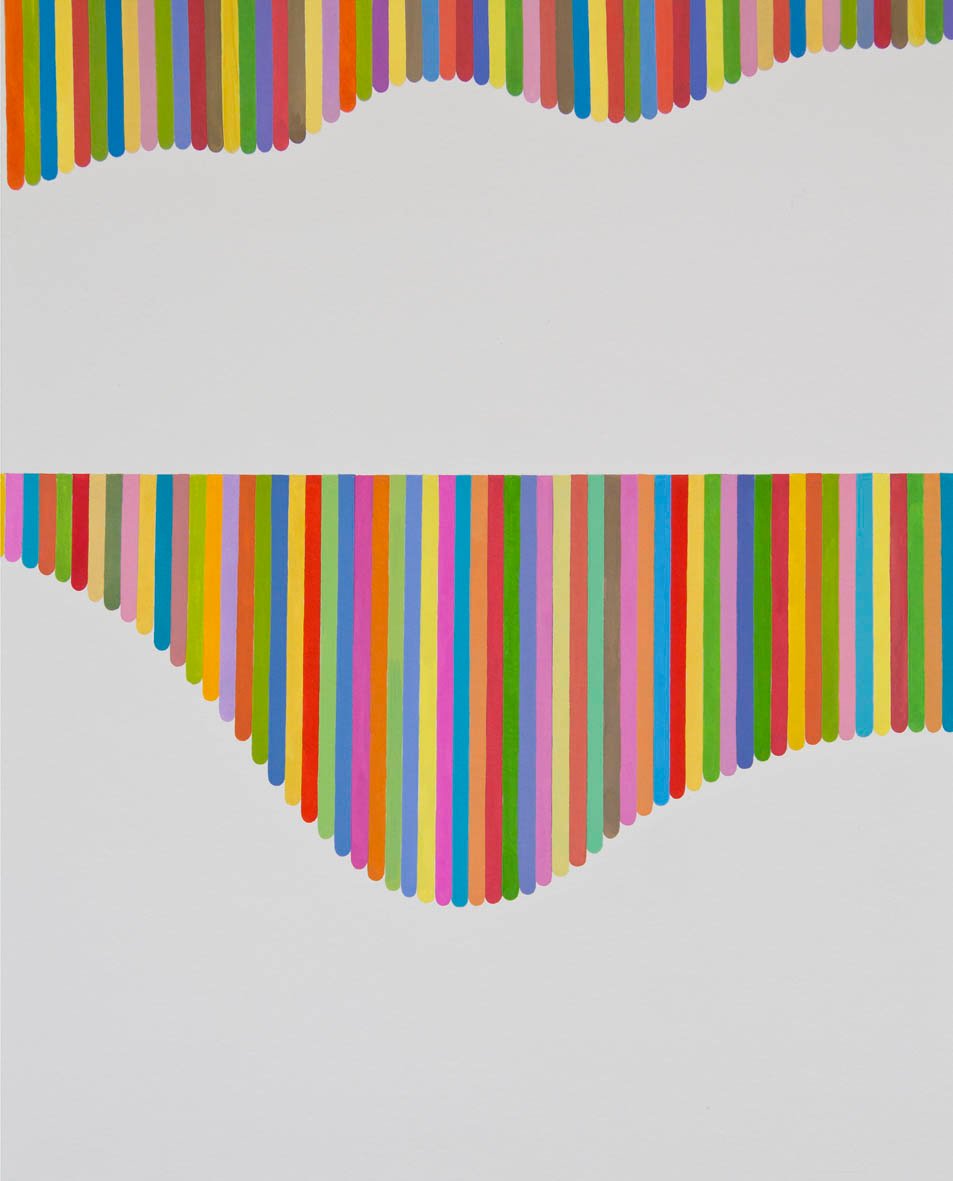
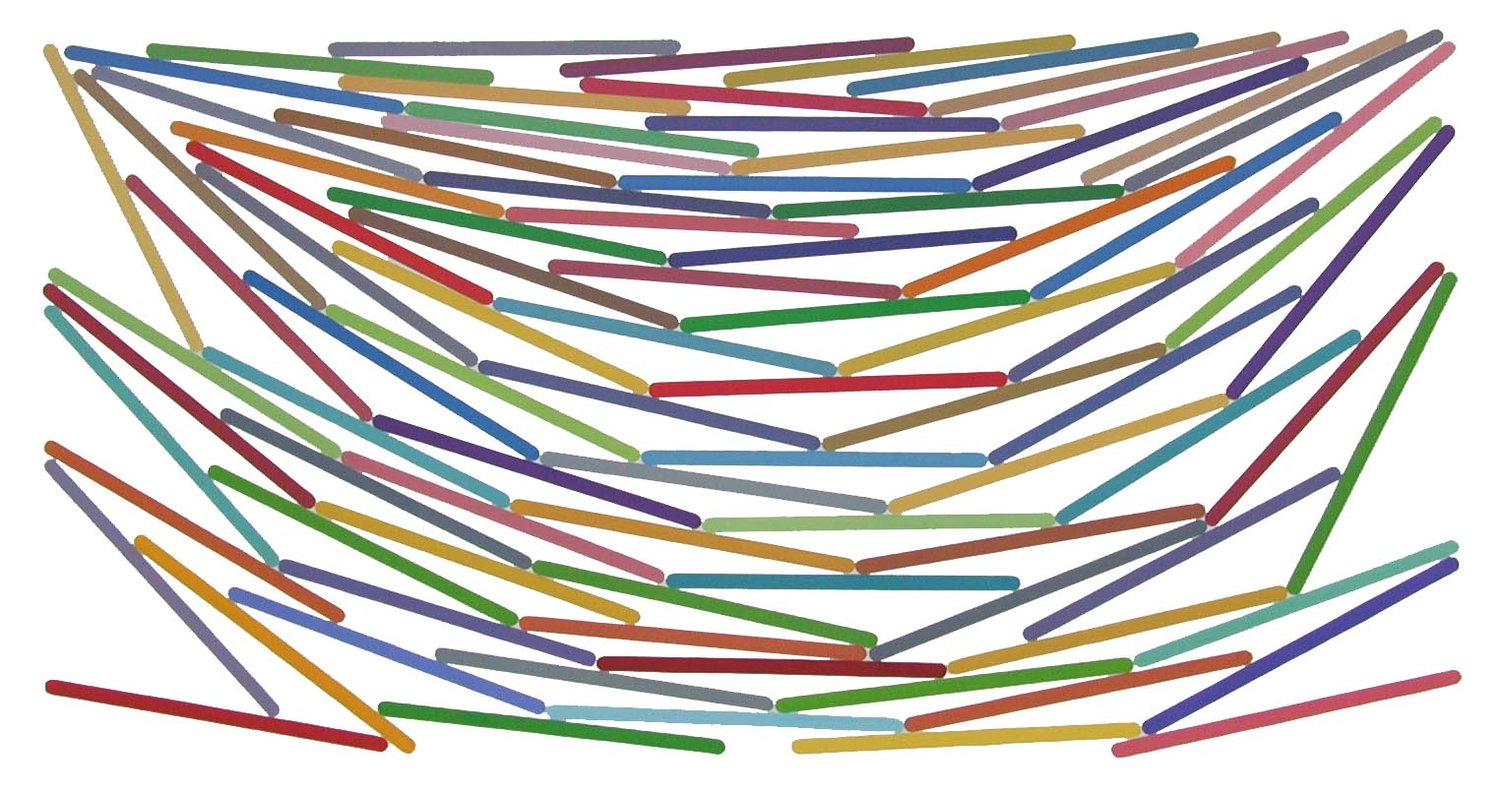

A lire également
Quid de l’organisation révolutionnaire ?
Le conflit pour faire démocratie
Rennes, une citoyenne à la mairie