La société contemporaine nous pose question : de plus en plus fragmentée et individualisée mais qui dans le même temps suscite des « conflits identitaires » et nationalistes comme jamais…
Les liens sociaux se sont délités : de « communautaires » ils ont plutôt pris la forme de réseaux plus nombreux et étendus mais aussi plus lâches et distendus… De la famille ou du village nous sommes passés à des dimensions mondialisées.
Notre société fait face à la fin des grands récits rassembleurs des XVIII, XIX, et XX -ème siècles (S. Citron, par exemple, démonte les représentations du mythe de la nation) à une défiance vis-à-vis des institutions quelles qu’elles soient, à l’abandon de l’État social, et aux populismes de toutes sortes.
Les appartenances de classe, de territoires, de proximité, et même de famille ont laissé le champ libre à des individus à facettes multiples en manque d’identités et d’appartenances…
Pourtant des solidarités existent et se révèlent notamment dans les moments de crise : solidarités de voisinage, de travail, de luttes…
Pourtant les nations défendent leurs identités de territoire, de langue, de culture face à des agresseurs ; les régions promeuvent leur culture comme ciment d’identité…
Et si, paradoxalement, c’était justement le rôle et la fonction du politique de recréer ce lien qui fait « nous » entre les citoyens, et/ou les individus… non pas la politique politicarde de luttes entre des Egos tous aussi surdimensionnés les uns que les autres, mais la politique du discours, de l’agir, du projet, des objectifs… et de la démocratie…
De la mairie à la Nation en passant par le département et la région, le politique est censé définir et organiser, ou tenter d’organiser (si possible à travers la démocratie, mais pas seulement), un vivre ensemble et un avenir commun… il s’agit de créer des cohésions sociales, et de rassembler sur un territoire à travers un ou des projets communs ; si le politique peine à susciter des identités au moins peut-il permettre des appartenances et des solidarités sous la condition expresse de pratiques démocratiques assurant la participation du plus grand nombre.
Lorsque l’écologie défend « une terre habitable pour les générations futures », propose de préserver le commun des équilibres environnementaux et sociétaux, et de changer la vie des gens, lorsqu’elle évoque « une énergie collective et rassembleuse » et un horizon politique désirable, lorsqu’elle aspire à un écosystème par une démarche participative lorsqu’elle veut « inverser la tendance destructrice pour la planète » et « ensemble changer le monde », c’est bien un destin commun qu’elle oppose aux individualismes.
Lorsque socialistes et communistes évoquent « un monde d’après plus social, écologique, démocratique, et féministe ; qu’ils décident de prendre en charge le destin des peuples, qu’ils proposent les moyens de promouvoir le social, la justice, et la cohésion sociale ». Lorsqu’ils défendent la culture, l’école, la sécurité dans une société solidaire, et des politiques sociales au service de tous, lorsqu’ils s’opposent à l’individualisme et au chacun pour soi du libéralisme notamment économique, lorsqu’ils veulent Instituer politiquement la société « sous tous ses aspects face au capitalisme et à la propriété privée … », c’est bien de « Nous » et de commun qu’ils parlent contre l’individuation.
Même la droite quand elle défend le nationalisme et le protectionnisme fait référence à un Nous, même si ce n’est absolument pas le nôtre… puisque la nécessité est, en effet, aujourd’hui d’un « Nous » international et non refermé sur un chacun pour soi !!!
On peut faire la même démonstration pour les syndicats qui tentent de défendre aussi des « communs » face à la fragmentation du travail mais gagneraient aussi à plus de participation démocratique.
Bénédicte Goussault
Image : ©https://mencoboni.com

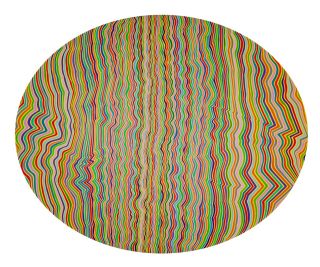
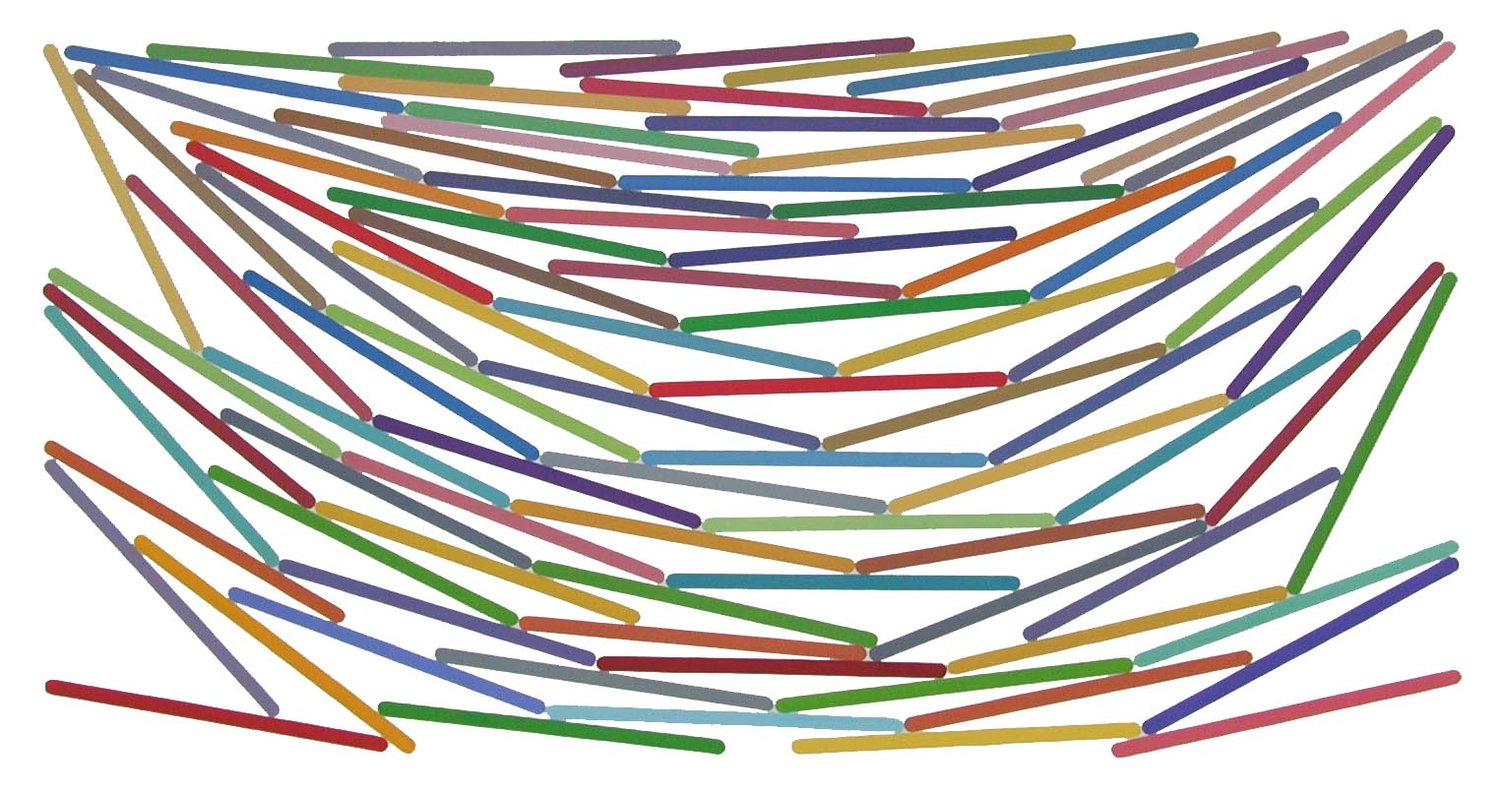

A lire également
Quid de l’organisation révolutionnaire ?
Le conflit pour faire démocratie
Rennes, une citoyenne à la mairie