En France, dans les années 1970/1980, deux mouvements collectifs l’utilisèrent. Les opposantes et opposants à l’énergie nucléaire retiraient de leur facture EDF une part correspondant aux investissements liés au programme de construction des centrales, revendiquant que ce soit consacré à des alternatives écologiques. C’est dans la même période, qu’autour des paysans et paysannes du Larzac qui refusaient l’extension d’un camp militaire, les comités Larzac présents dans de nombreuses villes du pays organisèrent, parmi bien d’autres actions de désobéissance, l’autoréduction de l’impôt sur le revenu : 3%, liés aux dépenses militaires, étaient retirés. Ces actions n’avaient pas pour but de réduire les dépenses personnelles des militantes et militants – d’autant qu’ils et elles reversaient ces sommes aux mouvements de soutien – mais de montrer que les citoyens et citoyennes peuvent, doivent, décider des investissements collectifs à faire ou non, des choix politiques. Plus directement lié à la question des prix et de l’inflation, on peut citer deux exemples : les transports gratuits ou les loyers.
A partir de comités de quartier créés dans la foulée de 1968, un grand mouvement d’occupation de maisons toucha l’Italie. « A Rome, 70 000 prolétaires parqués dans des ghettos et dans des conditions catastrophiques ont en face d’eux 40 000 appartements vides qui ne trouvent pas d’acquéreurs ou de locataires en raison du coût des loyers ». C’est par centaines que les réquisitions ont lieu, tandis que l’autoréduction des loyers se généralisait à Rome, Milan ou Turin. En France, Droit au logement a remis au goût du jour et assez fréquemment cette pratique à compter de ce qu’on pourrait appeler « les années 95 ». C’était un prolongement aux actions menées par des associations de chômeurs et chômeuses comme l’APEIS, pour interdire l’entrée d’immeubles HLM aux huissiers. Lié aux crises sociales, économiques et politiques, les occupations de logements vacants tiennent aussi à l’existence ou non de mouvements collectifs les assumant ; c’est ainsi qu’en Grèce par exemple, elles sont nombreuses et devenues emblématiques de quartiers d’Athènes par exemple. De fait, il s’agit bien d’une autoréduction du coût du logement ! Tout comme la réquisition de nourriture dans les supermarchés par les organisations de chômeurs et chômeuses répond au besoin de se nourrir, alors que la situation économique ne le permet pas.
Deuxième exemple : les transports collectifs. Là encore, l’Italie de la fin du XXème siècle peut être citée en exemple. En France, le Réseau pour l’abolition des transports payants (RATP) assuma cette lutte durant de nombreuses années ; il resta cependant cantonné à certains milieux militants. Des collectifs existent aujourd’hui, qui mutualisent la prise en charge des éventuelles amendes. Mais l’une des expériences les plus intéressantes est celle du Collectif sans ticket, actif à Bruxelles et Liège jusqu’au début des années 2000. Il édita une carte de droit aux transports, utilisée par quelques milliers de personnes, et organisa diverses actions publiques qui permirent des acquis notables (gratuité pour certaines catégories, tarifs dits sociaux, et aussi débat public sur le rôle, l’utilité, la gestion des transports collectifs). Le collectif se définissait ainsi : « […] des réseaux d’usagers des transports en commun réunis par la volonté de promouvoir le rôle moteur de ces services publics comme instruments d’émancipation collective et de recomposition des manières d’habiter et de parcourir les territoires, de se former, de susciter des processus politiques “par en bas”,… bref, de produire des situations par où passent la liberté et la solidarité ».
Christian Mahieux
-
Yann Collonges et Pierre Georges Randal, Les autoréductions. Grèves d’usagers et luttes de classes en France et en Italie (197261976), éditions Christian Bourgois, 1976.
-
Par analogie avec le terme fréquemment utilisé pour « les années 68 », c’est-à-dire les années qui précèdent et suivent l’évènement central, en l’occurrence la grève de novembre-décembre 1995.
-
Collectif sans ticket, Le Livre-Accès, Editions Le Cerisier, 2001.

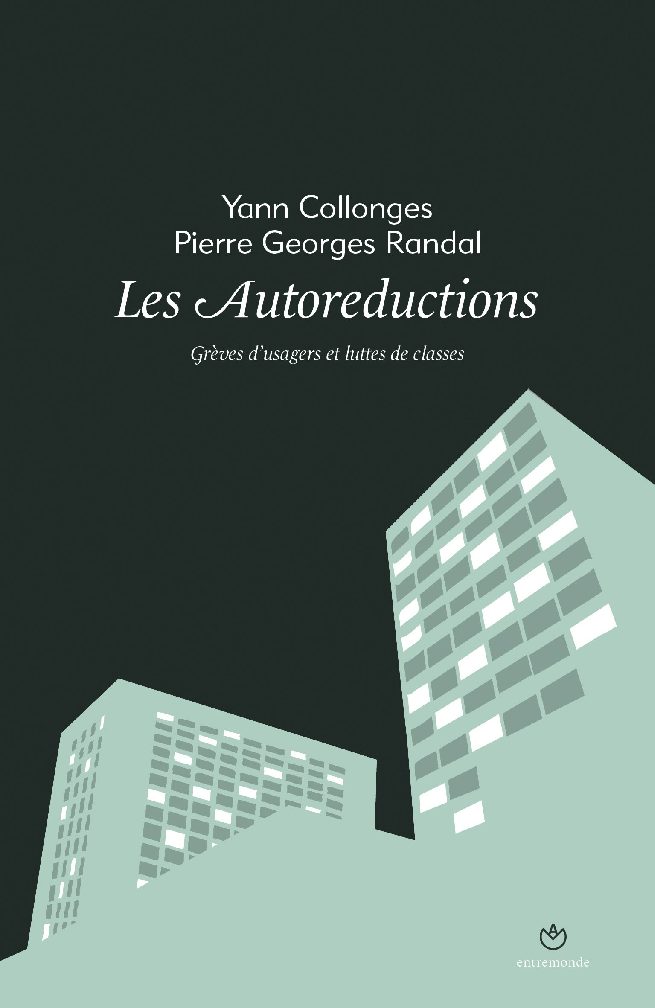


A lire également
Quid de l’organisation révolutionnaire ?
Le conflit pour faire démocratie
Rennes, une citoyenne à la mairie