L’apport des féministes qui ont pensé le travail domestique comme travail gratuit n’a pas été de dire « dégageons l’amour et regardons juste l’exploitation » mais de nous obliger à penser les deux, ensemble. Elles nous ont poussé·es à sortir de la pensée dichotomique produite et entretenue par l’ordre social patriarcal et capitaliste, et à prendre acte du fait que, non seulement l’exploitation ne s’oppose pas à l’amour ni d’ailleurs à la passion ou à l’engagement, mais que ces derniers pouvaient même en être un ressort principal. Ce faisant, elles ne nous ont pas dit pour autant que les sentiments, les affects ou l’engagement citoyen, étaient réductibles uniquement, et pour toujours, à une mystification du Capital. En mettant en lumière la façon dont la valeur pouvait être produite sur le dos de nos valeurs et combien nous étions, en quelque sorte, doublement exproprié·es par ce processus, elles ont montré comment on devait lutter pour se réapproprier notre travail, la valeur – et le monde – qu’il produit, mais aussi les valeurs pour lesquelles nous sommes prêt·es à nous y engager. En construisant une autre analyse de l’exploitation, elles ont dessiné une autre perspective pour l’émancipation : une perspective où l’émancipation ne se joue pas dans l’« en-dehors » du travail mais dans sa réappropriation, une perspective qui se propose de redéfinir et de réunir la classe des travailleur·ses dans l’espoir d’en dégenrer, enfin, la figure.
Contester les frontières du travail et mettre en lumière les rapports sociaux qui les construisent a un prix : le constat que nombre des revendications émancipatrices portées par la gauche pour « libérer du travail » s’appuient en réalité sur une conception androcentrée de celui-ci. L’équation « baisse du temps de travail égale plus de temps hors travail » pose question… plus de temps « hors travail » pour qui – ou ce qui revient au même : de quel « travail » parle-t-on ici? Le temps libéré du travail (salarié) est-il nécessairement du temps libéré du travail ? de l’exploitation ? Et donc du capitalisme ? Plus de temps libre pour faire quoi ? Plus de bénévolat et de volontariat pour faire tenir, coûte que coûte, nos services publics sous perfusion ? Plus d’économie collaborative sur Internet pour enrichir les GAFA ? Plus de travail domestique, familial ou de care, mais plus pour qui ? Pour les hommes ? Et comment ? Par quel mécanisme prendraient-ils soudain leur part ? Pour les femmes, donc, vraisemblablement… mais lesquelles ? Celles des classes moyennes ou supérieures qui en ont, elles aussi, transféré, en partie au moins, la charge, dans des conditions de travail et de rémunération pour le moins précaires, sur les épaules des femmes racisées des classes populaires ? Et quand le temps « libre » de l’emploi d’une partie de ces dernières est consacré à un « travail de subsistance » quotidien, est-ce vraiment davantage de ce temps gratuitement consacré à rechercher l’équilibre des conditions matérielles de l’existence individuelle ou familiale qu’il nous faut revendiquer ? Du point de vue d’une conception du travail au féminin neutre, le risque est grand que l’appel à la libération « du » travail ne se transforme en réalité en manne de travail gratuit pour le monde associatif, les services publics, les entreprises et, in fine, le système capitaliste… sans le moins du monde régler les enjeux de classe, de genre et de race de la division du travail, enjeux qui sont encore plus prégnants dès que l’on intègre le travail invisible et gratuit dans l’analyse. (…) Au lieu de rêver de traverser les frontières pour conquérir un « hors-travail » pour le moins situé socialement, ne nous faut-il pas plutôt chercher à récupérer le crayon qui les trace ? L’enjeu politique du travail, ce n’est pas son périmètre mais sa propriété. L’enjeu, c’est la réappropriation de notre travail au sens de ce qui produit nos vies, c’est « notre souveraineté sur le travail » pour reprendre l’expression de Bernard Friot. Mais, et c’est bien là que les frontières importent, cette souveraineté ne pourra être totale, au sens de nous concerner tout·es, que si elle porte à la fois sur notre travail productif et notre travail reproductif, sur le visible comme travail et l’invisible comme tel – que celui-ci soit exercé de gré ou de force –, sur ce travail qui est aujourd’hui rémunéré et celui qui ne l’est pas.
Maud Simonet
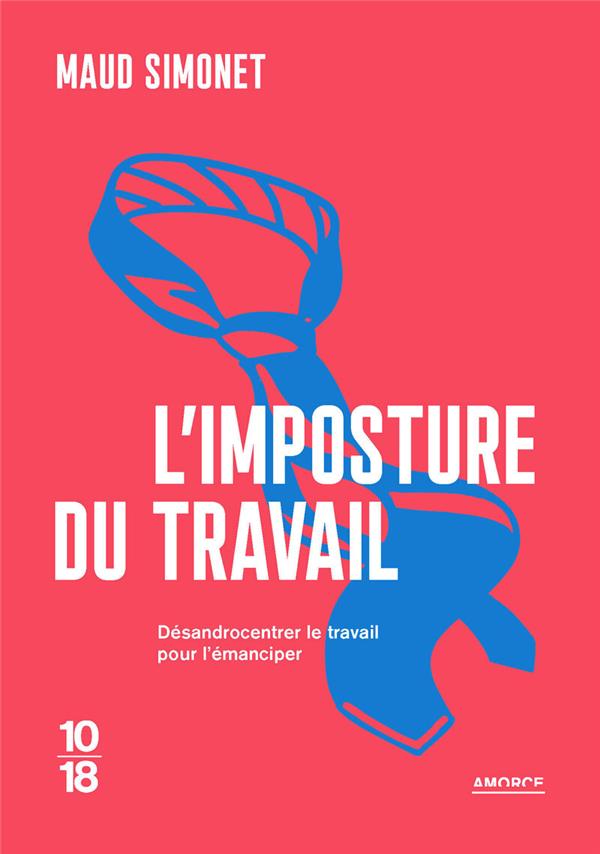
Extrait de : L’imposture du travail- Désandrocentrer le travail pour l’émanciper, 10/18, 2024, pp 68-71



A lire également
Quid de l’organisation révolutionnaire ?
Le conflit pour faire démocratie
Rennes, une citoyenne à la mairie