Article publié dans Alternatives Humanitaires. N°27 coordonné par Rauny Brauman, De l’Ukraine à Gaza regards croisés
Nous faudrait-il renoncer à tout – à l’humanité, à l’humanitaire – parce que les « inquisiteurs contemporains », de Boutcha à Rafah, en passant par Izium, Be’eri, Khan-Younes et au-delà, ont fait le choix du nihilisme ? Revisitant Camus, comme on le fait souvent quand on est désespéré et que l’on recherche une voix pour nous inspirer, Christophe Courtin fait entendre celle de l’auteur du Premier homme. Les luttes féministes qui partout dans le monde remettent en cause les dominations inscrites dans les rapports humains, peuvent être la boussole humaniste contemporaine des droit naturels à l’origine du droit international.
Il y a soixante-treize ans, aux premiers temps de la guerre froide, en introduction de L’homme révolté, Albert Camus écrivait que les massacres au nom de l’amour des hommes « désemparent, en un sens, le jugement[2] ». Pendant cette période, chaque camp – disons libéral et communiste – dénonçait les crimes de celui d’en face pour engager ses guerres. Au temps des crimes par idéologie, entre les années 1950 et jusque dans les années 1990, on justifiait les rapports de force économiques et géopolitiques au nom d’une vision du monde et l’on s’interrogeait sur le mal immédiat, sur son coût pour un progrès à venir, sur ses fins. La possibilité de droits universels était la question, même si cette morale universelle habillait bien souvent de prosaïques intérêts géostratégiques. L’effroi suscité par les conséquences de l’idéologie nazie avait amené chaque camp à élever la formule camusienne « un homme çà s’empêche[3] » au niveau de l’humanité tout entière.
à côté des crises humanitaires du Soudan, en République démocratique du Congo ou encore au Yémen, assistons-nous en Ukraine et à Gaza, désemparés face à cette litanie de massacres au nom de la haine, à l’arrivée de ce que Paul Celan appelait « l’avant troupe métallique du prochain siècle primitif[4] » ? De fait, ne s’agirait-il pas plutôt du retour de ces « troupes métalliques » qui se faisaient entendre avant la Seconde Guerre mondiale ? En 1999, le CICR faisait état de 20 conflits actifs, il y en a plus de 120[5] en 2024. En un sens, aujourd’hui, ce qui désempare toujours notre jugement, plus spécifiquement devant le conflit russo-ukrainien et celui entre Israël et la Palestine à Gaza, ce serait à nouveau l’absence de fins, de sens, sinon la force brute, la violence et la domination pour imposer des intérêts, accompagnée d’une dégradation morale universelle que Camus aurait vue, encore une fois, comme constitutive du nihilisme où tout devient permis. Ce « désemparent », cette prise de conscience de l’absurdité du présent naît de la confrontation de notre besoin de sens face à la souffrance humaine et à la rationalité de la violence.
L’acmé des droits de l’Homme
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la déclaration universelle des droits de l’Homme était adoptée le 10 décembre 1948. La veille, l’Assemblée générale des Nations unies adoptait la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et huit mois plus tard, le 12 août 1949, les quatre nouvelles Conventions de Genève étaient signées. Cette séquence d’adoption de textes fondateurs du droit international était l’expression de valeurs universelles après les trente années de l’implosion européenne entre le début de la Première Guerre mondiale et la fin de la seconde. On y affirmait que l’homme en tant qu’individu possède des droits inaliénables, dont la liberté et la résistance à l’oppression, et que sa dignité doit être protégée. La dynamique enclenchée par les premières formulations modernes du droit naturel à partir du XVIe siècle avait permis à la pensée occidentale de développer les principes des droits de l’homme qui sont devenus l’un des piliers du droit international. Avec les luttes contre l’esclavage, celles pour les droits civiques et politiques et les décolonisations, le puissant mouvement anthropologique des droits de l’homme a vu émerger la Croix Rouge et la première convention de Genève en 1864, le sans frontiérisme, les institutions onusiennes et le droit international humanitaire (DIH) avec tout le corpus juridique international de mise en œuvre des droits de l’homme.
Cette dynamique universalisante semble avoir atteint son acmé en 2002 avec la ratification par soixante Etats du traité international créant la Cour pénale internationale de La Haye. Depuis cette date, du fait de la prise de conscience du projet de domination coloniale qu’il portait aussi, l’universalisme occidental est radicalement remis en cause dans les pays du Sud global [6], notamment dans les parties du monde historiquement récipiendaires de notre aide au développement, de nos interventions humanitaires et de notre compassion. Ce procès à charge contemporain emporte même les principes du DIH qui semblaient définitivement acquis, même s’ils ont de tout temps été bafoués. Tout se passe comme si le capital moral de l’Occident avait été dilapidé dans ses opérations militaires depuis les guerres de décolonisation, en passant par le Viêt-Nam, jusqu’aux guerres menées au nom de la lutte contre le terrorisme à partir de la guerre en Afghanistan en 2001 et surtout celle en Irak de 2003. Aujourd’hui, aux yeux de ces pays du Sud global, le décalage des réactions des pays occidentaux entre l’agression russe contre l’Ukraine de février 2022 et les tapis de bombes sur les civils gazaouis depuis octobre 2023, le deux poids deux mesures a achevé la légitimité morale de l’occident fondée sur une raison dite universelle, devenue à leurs yeux simplement instrumentale et non plus émancipatrice de la personne humaine. Comme Camus en son temps face à la possibilité d’une apocalypse nucléaire, nous sommes à nouveau face à la gravité du présent qui voit croître la frénésie autodestructrice de beaucoup de dirigeants politiques que le droit international n’empêche plus.
Absence de fins
Jusque-là, la mondialisation des économies et l’aide publique au développement qui finance les associations, avançaient de concert, la seconde soignant les déséquilibres issus de la première. Les ONG de développement tentaient de combler ce fossé grandissant, les ONG humanitaires intervenaient quand les populations civiles étaient victimes de catastrophes dites naturelles ou des violences produites par les rapports de force géostratégiques. Les unes et les autres étaient encouragées – instrumentalisées aussi – et donc financées par les démocraties occidentales. Les organisations onusiennes, financées par les États, déléguaient une partie de leurs activités aux ONG. La « raison humanitaire » faisant partie du logiciel libéral, l’action humanitaire est maintenant largement perçue comme une forme de morale internationale associative sous-traitante de l’ordre occidental. En un sens, l’absence de fins qui désempare notre jugement serait ainsi l’aboutissement logique de « l’absence d’alternative[7]» à la mondialisation par la marchandisation du monde promue par le capitalisme où la marchandise et sa valeur deviennent le seul moteur anthropologique de l’activité humaine. Cette époque où, malgré tout, une forme de bienveillance – au pire d’indifférence – était portée sur l’action humanitaire par les pays intégrés dans la mondialisation économique semble, elle aussi, révolue.
Il y aura un avant et un après Gaza pour le secteur de l’humanitaire dont des travailleurs sont visés spécifiquement sans que l’Europe ou les Etats Unis n’interviennent réellement. La légitimité de l’UNRWA et celle de la Cour Internationale de Justice sont attaquées par les pays occidentaux. Il y aura également un avant et un après Marioupol pour le DIH : en mars 2022 les Russes bombardent un hôpital pour enfants, puis un théâtre où s’étaient réfugiés plusieurs centaines de civils, faisant des dizaines de victimes, sans que la Russie assume le massacre ou que ses alliés du sud global ne les dénoncent. Dès lors, l’action humanitaire et, plus largement, la solidarité internationale ont-elles encore un sens alors que le fondement juridique de leurs interventions est remis en cause par ceux-là même qui ont promu le droit international ?
La complaisance au nihilisme
Aujourd’hui, les déclarations des acteurs politiques et militaires russes, israéliens ou du Hamas, montrent-elles ce que Camus appelait dans l’Homme révolté « une complaisance au nihilisme », fruit mûr d’une acceptation de l’absurdité du monde où tout est permis au nom de la domination comme seul fondement de l’action ? Au regard de ce qui se passe aujourd’hui, il avait touché juste puisqu’il ajoutait : « A ce tout est permis commence vraiment l’histoire du nihilisme contemporain ». Ce qu’il ne pouvait pas observer, c’est que le XXIe siècle annoncerait le retour du meurtre de masse contre lequel le corpus des droits de l’homme et du droit humanitaire, bâti à l’issue de la seconde guerre mondiale, tentait de construire une digue. Quatre-vingt-trois ans après Babi Yar[8], des fosses communes de civils, les mains ligotées dans le dos sont à nouveau découvertes en Ukraine à Boutcha et à Izium. L’énoncé « pogrom » revient dans l’actualité pour qualifier les crimes de guerre et contre l’humanité perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023 au kibboutz de Be’eri. La possibilité d’un génocide en cours contre les habitants de Gaza est documentée par les institutions onusiennes à l’encontre du pays fondé en réponse à la culpabilité européenne après la Shoah. Dans les Frères Karamazov[9], le Grand Inquisiteur défend une vision du monde où les valeurs humaines les plus élevées doivent être sacrifiées au profit d’une stabilité sociale fondée sur l’illusion religieuse et l’autorité. Dans le discours qu’il prononce le 10 décembre 1957 à Stockholm pour la remise de son prix Nobel de Littérature, Camus reprend la question du consentement à la servitude posée par le Grand Inquisiteur. Il dit : « devant un monde menacé de désintégration, où nos grands inquisiteurs risquent d’établir pour toujours les royaumes de la mort, notre génération sait qu’elle devrait […] refaire avec tous les hommes une arche d’alliance. Il n’est pas sûr qu’elle puisse jamais accomplir cette tâche immense… ». Le DIH et le droit international des droits de l’homme fondaient cette arche d’alliance humaniste construite sur les décombres de la seconde guerre mondiale. Ils semblent dépassés avec le retour au meurtre, non plus au nom des idéologies, mais au nom du nihilisme lui-même, dans l’amoralisme contemporain des meneurs de guerre et de leurs alliés. Le discours de Camus venait après les folies meurtrières des deux guerres mondiales. Il soulignait la gravité du présent et il y a tout lieu de craindre que le mouvement nihiliste qui semblait avoir été contenu avec les grands textes de l’après-guerre, ne reprenne son cours irrémédiable.
La pulsation initiale
Tout semble à reprendre et pourtant la dynamique des droits naturels enclenchée en Europe ne s’arrêtera pas. Camus ne pense pas une résignation passive face à l’absurde du temps présent. Il soutient que dans un monde dénué de sens ultime, il est toujours possible de choisir une réponse humaniste en dépit de la violence absurde. Celle de nos grands inquisiteurs contemporains, pas plus que celle qu’a connue le monde de Camus en son temps, ne doit pas être acceptée comme une fatalité. Camus prône la révolte contre ces impasses morales, révolte qui se traduit encore et toujours par un engagement en faveur de la justice et de la dignité humaine. La fin de l’universalisme « à l’occidentale » ne peut pas sonner le glas de la possibilité d’un universel humaniste, fondement éthique de tout engagement dans l’humanitaire. L’universalité des droits naturels s’inscrit dans le long processus évolutif de l’hominisation qui voit l’émergence d’une espèce humaine dotée d’une conscience collective. Les grands textes de 1948 et 1949 étaient en phase avec cette onde originelle hominisatrice à basse fréquence venue des premiers temps de l’humanité et que les derniers évènements dramatiques en Palestine et en Ukraine perturbent. La pulsation lente se maintient en dépit des aléas, elle continue de se propager. La question de notre génération, aurait dit Camus, est de retrouver une nouvelle source d’énergie émancipatrice en résonnance avec celle des droits humains.
Centralité des luttes féministes
Les questions d’égalité entre les femmes et les hommes sont-elles en passe de réactiver cette énergie dans toutes les parties de la planète au-delà des différences culturelles ? Elles transcendent les guerres de civilisations que nos grands inquisiteurs nous vendent avec leurs passions tristes. Les luttes féministes ne sont plus seulement des questions politiques, judiciaires ou éthiques, mais en mettant en cause les situations de domination, inscrites au cœur des relations humaines, elles participent d’une évolution de l’ordre violent international. Bruno Latour[10] estimait que la centralité de la question du genre, sous toutes les formes possibles, même dans ses formulations les plus incompréhensibles dans les pays du sud global, pouvait être considérée comme la marque d’un doute généralisé sur les liens définis par la seule économisation néo-libérale des rapports humains, porteuse en elle-même de domination.
Penser que les femmes portent par nature des rapports égalitaires plutôt que de domination serait un stéréotype essentialiste de plus, mais leur présence désormais incontournable dans l’espace public mondialisé conditionne différemment les rapports de force et la violence, parce qu’elles-mêmes ont été dans l’histoire et sont encore l’objet de rapports de domination et de violence. Dans tous les pays, les luttes contre les violences domestiques, pour le droit à la contraception et à l’avortement, pour le droit à conserver son nom, contre les mutilations génitales, contre les prescriptions religieuses de vêtement, contre les féminicides, pour l’éducation des jeunes filles, pour l’égalité salariale, pour la paix, agrègent une configuration de révoltes locales contre l’absurdité guerrière d’un monde fondé sur un ordre masculin.
En Russie, dès les premières semaines de l’invasion de l’Ukraine, ce sont principalement des femmes qui ont organisé les manifestations anti-guerre dans plusieurs villes. Le mouvement “Féministes contre la guerre” a publié des manifestes et utilisé les réseaux sociaux pour mobiliser la société. Le Comité des mères de soldats de Russie, créé en 1989 à la fin de la guerre en Afghanistan, malgré la répression, demande toujours des comptes aux autorités russes, dénonçant le manque d’information sur le sort de leurs fils et sur les conditions dans lesquelles ils combattent. C’est une femme journaliste Marina Ovsiannikova qui a fait irruption dans un journal télévisé en mars 2022 pour dénoncer « l’opération spéciale » de Poutine. C’est en Ukraine que le groupe féministe Bilkis aide les femmes victimes de la guerre mais dénonce aussi les inégalités de genre dans la société ukrainienne. L’armée ukrainienne compte dans ses rangs une association féministe de soldates, Veteranka, qui combat le sexisme dans l’institution militaire. En Israël le mouvement Women in Black (Femmes en noir), fondé en 1988 pendant la première Intifada, est composé de femmes qui protestent contre l’occupation israélienne des territoires palestiniens. Le groupe de femmes israéliennes, Machsom Watch créé en 2001, surveille les postes de contrôle militaires israéliens en Cisjordanie pour documenter les violations des droits humains contre les Palestiniens. Même si le massacre du 7 octobre a ralenti les collaborations entre les ONG féministes palestiniennes et israéliennes sur une approche féministe pour la paix et la justice, Coalition of Women for Peace (CWP) créée en 2000 pendant la deuxième Intifada et Women Wage Peace, fondée en 2014 à la suite de l’Opération Bordure protectrice à Gaza, maintiennent les contacts entre elles.
Camus, finalement
On ne peut pas dire que Camus était féministe. Ses personnages féminins sont secondaires ou viennent en contrepoint de l’action du héros. Ses relations avec les femmes étaient celles de son époque, reflétant les constructions sociales des rapports entre les femmes et les hommes de son milieu intellectuel et de son identité narrative de pied noir : entre passion, valorisation de la figure de la mère, infidélité, séduction ou autorité. Il militait cependant pour la dignité humaine et l’égalité entre les êtres humains. Ces principes fondent aujourd’hui les luttes féministes et peuvent nous aider à maintenir la pulsation initiale des droits naturels contre l’absurde. C’est à cette immense tâche que notre génération doit s’atteler, même s’il n’est pas sûr qu’elle puisse jamais l’accomplir comme le craignait Camus dans son discours du Konserthuset de Stockholm, le 10 décembre 1957.
[1] https://www.alternatives-humanitaires.org/fr/
[2] Albert Camus. L’homme révolté. NRF Gallimard 1951.
[3] Albert Camus. Le premier homme. NRF Gallimard 1994.
[4] Paul Celan. Partie de neige. Traduction Française Seuil 2007.
[5] Déclaration de Mirjana Spoljaric à l’occasion du 75e anniversaire des Conventions de Genève.
[6] Il y a soixante ans on disait les pays du Tiers-Monde, il y a 30 ans les pays en développement. Malgré leur nouvelle puissance mais du fait de leur histoire, la Chine, le Brésil et l’Inde appartiennent au Sud Global.
[7] Margareth Thatcher “Yet I believe people accept there’s no real alternative to the market economy”. Convention des femmes du parti conservateur du 21 Mai 1980
[8] Le massacre de Babi Yar à Kiev les 29 et 30 septembres 1941 où 33 771 Juifs furent assassinés.
[9] Dostoïevski. Les frères Karamazov (trad. du russe par Kyra Sanine), « Classiques Garnier » 2014
[10] Bruno Latour. La Religion à l’épreuve de l’écologie. Exégèse et ontologie. Livre d’entretien. La Découverte 2024

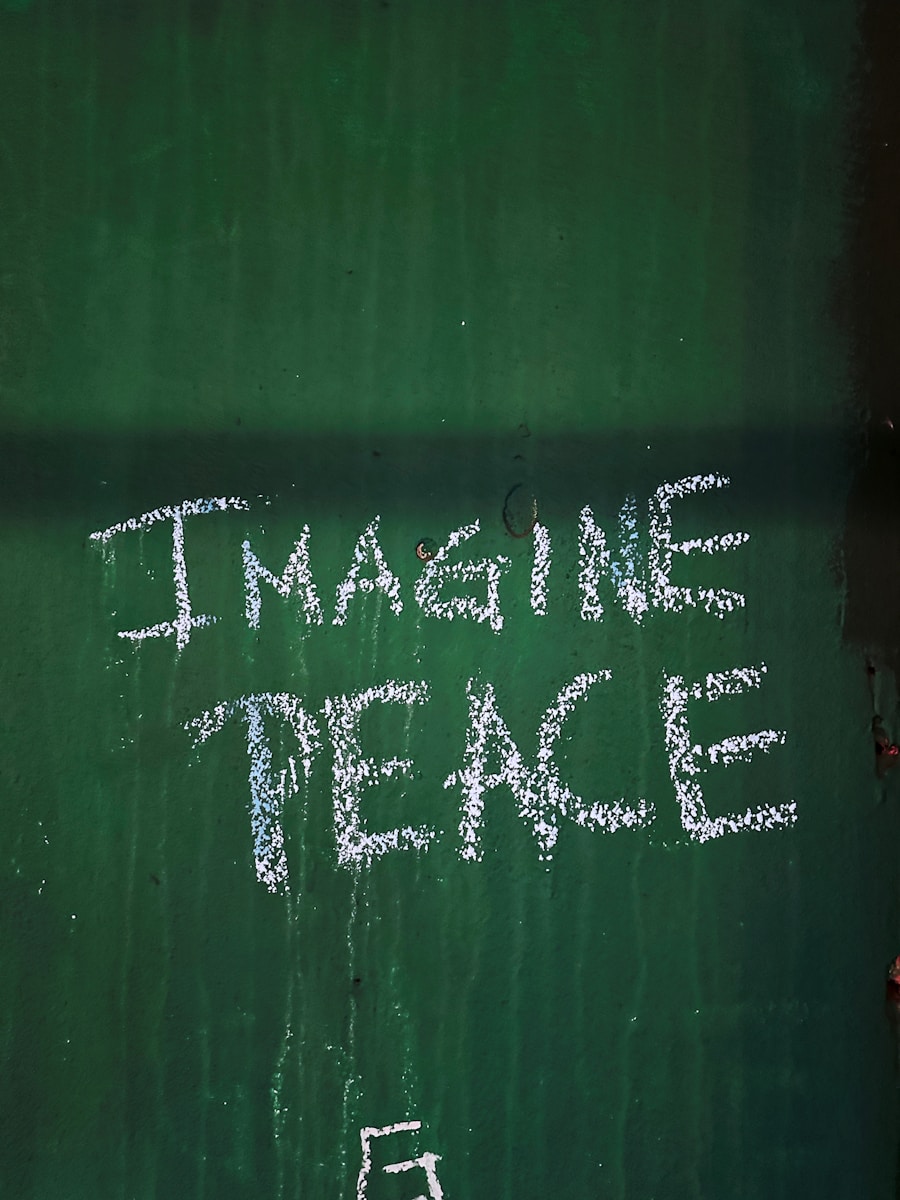

A lire également
Inconnu au bataillon
Obsolescence du capitalisme, immédiateté de la visée, rapport de force
Que nous disent les luttes…?