Prologue : Le numérique bouleverse la démocratie, le travail, les liens sociaux. Il peut être à la fois un formidable outil d’émancipation et un outil démesuré de surveillance et de manipulation de masse. Peut-on s’appuyer sur les pratiques numériques alternatives sans remettre en cause les géants du numérique pour dépasser ce nouveau capitalisme informationnel ? Cerises ouvre le débat. Loin d’être exhaustif, le dossier de ce mois de janvier appellera des suites.
A propos du numérique : L’urgence d’un choix de société.
S’il est impossible d’aller à l’encontre du progrès des connaissances et ce n’est pas notre optique, ce n’est pas pour autant qu’il faut considérer tous les choix technologiques comme s’ils étaient socialement et politiquement neutres. On a pu vérifier depuis Hiroshima que la maîtrise de la fission de l’atome n’était pas sans problème.
Le numérique ouvre dans quasiment tous les domaines, une ère nouvelle dont tous les contours sont encore difficiles à saisir.
Incontestablement il apporte des progrès au travail, à la vie courante, à celle des associations, organisations, à la communication….
En même temps, outre la fracture numérique qui touche une partie de la population, le numérique porte en lui des dangers encore difficiles à imaginer. Dangers de modes d’exploitation du travail et pour la sociabilité, dans la transmission de la culture favorisant la course à l’instantané et au superficiel, et les algorithmes favorisant le conformisme. Transmission et concentration de données à l’insu des utilisateurs, à des fins commerciales (on a vu l’Implication de Zuckerman) mais aussi à des fins politiques et capacité de mise sous surveillance et sous tutelle de la population ; capacité de manipulation de masse…
Derrière ces dangers n’y a-t-il pas une forme inédite de pouvoir qui se met silencieusement et insidieusement en place et qui deviendrait obscur et difficile à situer ? N’y a-t-il donc pas le risque d’un glissement de la société vers un nouveau type de totalitarisme ?
Face à cela, au-delà des alertes, au-delà de la multiplication des logiciels libres et de la quête d’une gestion participative de réseaux, n’est-il pas temps d’ouvrir un débat public plus large sur ces dangers et de commencer à construire une démocratie dont la protection dépend de l’engagement de l’ensemble de la population ?
Préparé par Bruno Bessière, Alain Lacombe, Sylvie Larue, Pierre Zarka, le dossier donne la parole à plusieurs auteurs et autrices.
- Maryse Artiguelong vice-présidente de la Ligue des Droits de l’Homme nous alerte sur les conséquences de la collecte des données.
- Pascal Plantard anthropologue des usages du numérique aborde les enjeux du numérique à l’école.
- Nathalie Pradelle s’interroge sur le devenir des collectifs de travail dans ce contexte de développement du télétravail. La Quadrature du Net met à notre disposition plusieurs articles pour mieux comprendre les enjeux de l’utilisation du numérique à des fins liberticides.
- Nous publions des extraits du livre Techno-féodalisme de Cédric Durand avec l’aimable autorisation de son auteur.
- Alain Lacombe, Pierre Zarka traitent de la révolution anthropologique à l’œuvre et des liens avec le système capitaliste,
- tandis que Christophe Aguiton, et l’association des plateformes coopératives développent l’idée que des pratiques collaboratives rendues possibles par le numérique constituent des alternatives aux logiques capitalistes.
- Catherine et Gracchus Destom-Bottin nous livrent leur billet d’humeur sur le tout numérique.
Bonne lecture
L’équipe de rédaction
Révolution anthropologique/ Révolution politique
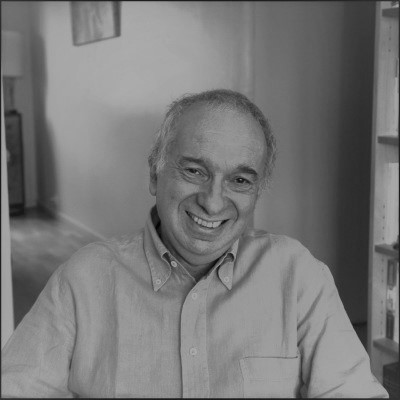
Nous sommes face à un changement de portée anthropologique.
Les technologies ne se limitent plus à amplifier ou à se substituer à la force musculaire, elles amplifient et objectivent les opérations intellectuelles. Le numérique entraîne un plus large processus de socialisation des actions humaines et des enjeux qui en découlent. Les serveurs s’adressent de manière individualisée à chacun(e), en même temps ils en dégagent des tendances collectives lourdes. Cela génère une nouvelle puissance sociale qui change en profondeur le rapport individu/collectif. Ce phénomène peut basculer vers deux sens diamétralement opposés. Il nourrit une profonde exigence de démocratie. Mais ce débouché est d’autant moins fatal que pour l’instant cette puissance est accaparée par le capital.

De plus, l’individu a besoin de se situer sur l’axe du temps pour se construire. Des neuropsychologues expliquent que la lecture traditionnelle a développé au fil du temps les circuits neurologiques de la concentration, de la réflexion et de l’abstraction au détriment des circuits courts de l’alerte de nos ancêtres chasseurs et guerriers. La navigation sur internet atrophierait ces circuits longs au profit du retour de l’alerte.[1] La recherche doit être immédiatement satisfaite, le long devient du temps perdu. Plus les liens hypertextes augmentent et plus on lit et on raisonne par fragments. La capacité à se situer dans la temporalité donc à mettre en cohérence est menacée. L’attachement et la dépendance individuelles au Big Data bouleversent le mode de production. La monopolisation de déterminants psychologiques, sociologiques et politiques va désormais caractériser la puissance du capital. L’élargissement des surfaces des données et de leur utilisation sont au cœur de son redéploiement. Une force de pouvoir et de domination se construit en silence : un nouveau rapport entre plateformes liées au capital et État. Obama, Trump, Poutine en sont des prototypes. L’interconnexion qui en découle change la place de l’État et afin d’accroître la plasticité du système en accroît aussi l’instabilité. Si la dénonciation du néo-libéralisme, de l’austérité et de la concurrence exacerbée n’est pas encore totalement dépassée, elle est déjà en retrait sur les nouveaux modes d’exploitation et de domination. On ne corrigera pas ces effets seulement par le numérique mais par le politique, quel que soit l’apport des formules alternatives. Savoir qui des citoyens ou des capitalistes détient le pouvoir sur la société est incontournable. La pandémie a fait apparaître des fragilités idéologiques du capitalisme. Outre la financiarisation de l’économie, les gains sont davantage liés à la prédation qu’aux activités. Ni les marchés financiers, ni la concurrence tant vantée n’ont répondu aux besoins. Nous sommes passés de « trop d’État » à l’omniprésence de Macron à la télé et du refus de la dette publique à l’usage massif de la planche à billets.
[1]Relaté par Coline Tison dans Internet : ce qui nous échappe ; Ed. Yves Michel 2015.
Un redéploiement du capitalisme
Extraits du livre Techno-féodalisme de Cédric Durand

En cherchant à dénoncer ce qu’il y a de neuf dans la dynamique de surveillance on risque de normaliser le capitalisme lui-même. Ce qui manque à la thèse du capitalisme de la surveillance, c’est un questionnement en termes d’économie politique. Quelles modifications du mode de production ? Entre le social et les Big Data, il y a plus qu’une analogie. Les Big Data ne sont bien sûr pas tout le social, mais elles sont du social. Elles procèdent d’un mouvement dialectique : cristallisation symbolique de la puissance collective saisie dans les régularités statistiques ; puis rétroaction de celle-ci sur les individus et leurs comportements. La capture des données nourrit les algorithmes, et ceux-ci viennent en retour guider les conduites, les deux se renforçant mutuellement dans une boucle de rétroaction.
L’effet de transcendance qui résulte de la collecte et du traitement des données immanentes, est d’autant plus fort que leur nombre est grand. Mais le revers de cette puissance des grands nombres est un risque de perte de contrôle. Ce qui est possible à l’échelle des petits nombres en termes de pleine conscience partagée des ressorts et des effets de la vie collective devient, à l’échelle des grands nombres, une affaire de spécialistes, un job de data scientistes. Difficile pour la multitude de s’autosaisir de sa propre puissance lorsqu’elle ne la reconnaît pas, celle-ci lui étant devenue étrangère. Voyez dans les Big Data non pas des faits techniques, mais des faits institutionnels. Pour ces derniers ce qu’il s’agit de capturer ce ne sont pas fondamentalement les données elles-mêmes, mais bien ce qu’elles recèlent de puissance sociale. Dans le mouvement descendant, cette puissance investit les individus, elle étend leur capacité d’action en les dotant des ressources cognitives de la force collective. Mais ce retour de la puissance du social opère sous l’empire des pouvoirs qui l’agencent : l’individu est ainsi simultanément augmenté de la puissance du social restituée par les algorithmes et diminué dans son autonomie par les modes de restitution. Ce double mouvement est une domination, car la capture institutionnelle est organisée par des firmes qui poursuivent des fins qui leur sont propres, sans rapport avec celles que pourraient se donner les intéressés.
L’être humain augmenté de notre âge numérique n’échappe pas davantage à l’empire des algorithmes que l’être humain socialisé n’échappe à l’empire des institutions.

Les plateformes ont intérêt à enserrer les utilisateurs dans leur écosystème en limitant l’interopérabilité avec leurs concurrents. Les plateformes sont en train de devenir des fiefs. Outre la logique territoriale d’accaparement des sources de données originales, la boucle de rétroaction inhérente aux services numériques crée pour les sujets une situation de dépendance. Parce que les algorithmes qui se nourrissent de l’observation de nos pratiques sont en train de devenir des moyens de production indispensables à l’existence ordinaire, mais aussi parce que l’inscription des individus dans les plateformes y est rendue durable par un effet de verrouillage dû à la personnalisation de l’interface et à des coûts de sortie élevés. En fin de compte, le territoire numérique organisé par les plateformes est fragmenté en infrastructures rivales et relativement indépendantes les unes des autres. Qui contrôle ces infrastructures concentre un pouvoir à la fois politique et économique.
Technoféodalisme, Critique de l’économie numérique, Cédric Durand, Éditions de la Découverte, 2020, 18 euros
Une autonomie en trompe l’œil
Cédric Durand dans Techno-féodalisme
Le cas Uber est paradigmatique : les travailleurs sont-ils des indépendants qui contractent librement avec Uber ? Ou bien doivent-ils être considérés comme des employés de la plateforme et bénéficier à ce titre des protections que procure le salariat ? Les autorités françaises ont suivi l’argumentaire des plateformes qui nient être des sociétés de service traditionnelles et se présentent comme des entreprises technologiques mettant en relation consommateurs et entrepreneurs individuels. La question est d’abord celle de la rémunération du travail. Si Uber insiste tant sur l’indépendance des chauffeurs, c’est parce que leur requalification en salariés représenterait un surcoût très significatif, de l’ordre de 20 % à 30 % dégrevé du coût des obligations d’employeurs. Si la question de la subordination ne se pose pas exactement dans les mêmes termes que dans l’emploi classique, il est clair que le rapport entre travailleurs et plateforme est fondé sur une asymétrie radicale. Elle passe par le suivi et l’évaluation en continu du comportement et des performances des travailleurs, ainsi que par la mise en œuvre automatique de décisions. Les agents interagissent non pas avec des superviseurs humains mais principalement avec un système rigide et peu transparent, dans lequel une grande partie des règles commandant les algorithmes leur est inaccessible. Ainsi l’aspiration à l’autonomie se heurte à l’emprise extrêmement forte de la plateforme sur l’activité.
Accélération

Le numérique est en même temps un outil et un défi, ce peut-être le meilleur ou le pire, il est un enjeu de société majeur, à la fois par son activité propre et en ce qu’il fait société. « Les modèles économiques du numérique sont basés sur des usages permanents, une connectivité totale, des contenus surabondants et un trafic de données gigantesque » écrit Solange Ghernouti, directrice de recherche à l’université de Lausanne, elle ajoute : « le numérique est un secteur industriel qui contribue à épuiser les ressources naturelles (fabrication, utilisation) et à polluer la planète (consommation, obsolescence programmée, extraction des terres rares, déchets toxiques…) la consommation d’énergie fossile par le numérique a dépassé celle du trafic aérien ». La production de CO² de l’économie numérique approche les 4% du total, en progression de 8 à 10% par an. Même s’il y a des contre parties, c’est considérable. Et cela risque de s’accélérer. Dans une note aux investisseurs, la Caisse des dépôts indique à propos du numérique : « la croissance est souvent à la fois une opportunité et une obligation… la loi de « Metcalfe [1]» dit simplement que plus il y a d’utilisateurs dans un réseau, plus il a de valeur. Et on peut ajouter la durée de connexion (économie de l’attention) qui lui aussi pousse à une surchauffe du numérique. Mais au-delà de ces conséquences directes sur le climat, compte-tenu des choix politiques dominants, le numérique fonctionne comme un redoutable accélérateur de la mondialisation et de la concentration des capitaux.
L’idée grandit qu’avec le capitalisme, « on va dans le mur, » avec le modèle de fonctionnement actuel du numérique, on y va encore de plus en plus vite :
- Dans le temps : il priorise le temps court, les transactions se font en un clic, la spéculation galope…
- Dans l’espace : il facilite la mondialisation des échanges, la dispersion de la production, les délocalisations, « l’évaporation » fiscale, la destruction d’emplois…

On s’éloigne toujours plus vite d’une économie organisée en fonction des besoins
Internet devient le plus vaste et le plus important marché du monde. Or, l’économie du numérique repose pour l’essentiel sur les recettes publicitaires (85% pour Google, 98% pour Facebook) et sur la vente/marketing visant à optimiser la rentabilité (les plateformes, Amazon). Cela entraîne une accélération de la dérive consumériste, de la politique de l’offre. On s’éloigne toujours plus vite d’une économie organisée en fonction des besoins (valeur d’échange/valeur d’usage). Cette économie de l’offre exacerbée oriente et pervertit les choix de production, produit du gaspillage, de la pollution … Elle génère de la valorisation virtuelle accentuant la déconnexion entre richesse financière et richesse réelle (bulle financière). Le constat est redoutable mais ce n’est pas l’outil qui est en cause, au contraire, mais son utilisation dans le cadre du système capitaliste dont il contribue à accélérer la fuite en avant. Le défi que nous devons relever est de penser l’écosystème numérique véritablement au service du vivant.
Et ce n’est pas une question de technique mais de choix politiques.
[1] La loi de Metcalfe est une loi théorique et empirique de l’effet de réseau énoncée par Robert Metcalfe (fondateur de la société 3Com et à l’origine du protocole Ethernet). Source Wikipédia
La collecte des données personnelles et ses conséquences

L’Internet est une mine de services « offerts » : messageries, réseaux-sociaux, espaces de stockages «en nuage»… nous sont proposés sans contrepartie, pourtant l’adage « si c’est gratuit, c’est vous le produit » est toujours vérifié. Pour les entreprises du numérique (en particulier les Gafam[1]) les données personnelles sont une source de profit, le « pétrole du XXIe siècle ».
Du fait de la prolifération des outils numériques : ordinateurs, ordi phones (ou smartphones) dont les applications sont utilisées par environ 70 % de la population française, banalisation des objets connectés, connexions aux réseaux de plus en plus puissants (voir le déploiement polémique de la 5G[2]), baisse continue du coût de stockage, capacités accrues des algorithmes et de l’intelligence artificielle, les entreprises ont à leur disposition des masses d’informations sur nous. Ce sont d’une part nos données d’identification (y compris de plus en plus souvent des données biométriques lorsqu’il est proposé de s’identifier non plus par mots de passe mais par les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale), d’autre part toutes les « traces » que nous laissons dans nos navigations et nos échanges numériques mais aussi nos métadonnées[3].
Les données personnelles sont une source de profit
L’analyse de ces données personnelles permet par exemple de déduire nos consommations, profession, religion, orientation sexuelle, état de santé, convictions politiques, déplacements, adresse, lieu et collègues de travail, ami-e-s… Ceci permet aux entreprises du numérique de vendre à d’autres nos données brutes ou nos profils, à des fins publicitaires ou d’évaluations de risques (employeurs, assureurs, banques…). Ce modèle économique lie les revenus marketing à la quantité de données collectées, et les revenus publicitaires au trafic et au temps passé sur les sites ou les plateformes. Les entreprises ont donc développé, grâce aux algorithmes, des stratégies virales utilisant les « bulles de filtre » destinées à maintenir le plus longtemps possible des groupes d’utilisateurs sur leurs plateformes en les « alimentant » de propos censés refléter leurs opinions ou en infox (fake news) et qui de fait les manipulent.

Ces stratégies ne sont pas sans danger pour nos démocraties ainsi que l’a montré le scandale Cambridge Analytica[4]. Si le profilage lié aux publicités ciblées a pu sembler anodin, si certains relativisent la portée des infox, la surveillance généralisée qui a très tôt été étudiée et dénoncée par les défenseurs des libertés est un risque évident surtout depuis qu’Edward Snowden a révélé en 2013 que les entreprises du numérique divulguaient nos données aux services de renseignements de nombreux états. L’absence de confidentialité des données et la conscience de se savoir surveillés ont modifié la conduite de nombreux internautes pour obéir à une norme supposée, ce qui constitue une atteinte à la liberté d’information et à la liberté d’expression[5].
Face à ces dangers il existe des textes protecteurs élaborés pour maintenir la confiance et favoriser l’économie numérique mais aussi pour garantir les droits fondamentaux comme le droit à la vie privée et à la liberté d’expression. Ainsi le RGPD[6] renforce la notion de consentement, garantit le droit à l’oubli et la minimisation des données collectées.
Reste aux internautes à faire appliquer ces protections.
[1] Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, géants du numérique états-uniens.
[2] Cinquième génération de technologie de communication.
[3] Informations sur les données (expéditeurs, destinataires, date, lieu et durée de connexion…) qui ne peuvent pas être chiffrées, ce qui empêche l’anonymat des utilisateurs.
[4]Voir https://www.cnil.fr/fr/affaire-cambridge-analytica-facebook
[5] La pénalisation des consultations de sites relatifs au djihadisme (y compris à titre informatif) a ainsi généré une tendance à l’autocensure.
[6] Règlement Général pour la Protection des Données pour tous les résidents de l’UE.
Défendre nos libertés contre une surveillance massive de l’État au service de la répression politique
Pour notre de dossier de janvier nous avons sollicité l’association La Quadrature Du Net[1] (LQDN). « La Quadrature du Net promeut et défend les libertés fondamentales dans l’environnement numérique. L’association lutte contre la censure et la surveillance, que celles-ci viennent des États ou des entreprises privées. Elle questionne la façon dont le numérique et la société s’influencent mutuellement. Elle œuvre pour un Internet libre, décentralisé et émancipateur. » (présentation de LQDN par elle-même, sur son site).
Elle nous a autorisé à republier certains de ses articles sur notre site (voir les liens).
Nous en avons sélectionné 3 qui révèlent l’ampleur des pratiques en cours et des projets de surveillance, de contrôle politique et de répression de l’État.
Le premier article, La Technopolice, moteur de la « sécurité globale », montre que les dispositions de la proposition de loi Sécurité globale s’inscrivent dans une stratégie encore plus globale, exposée dans le Livre blanc de la sécurité intérieure, publié en novembre 2020. Celui-ci prévoit une utilisation massive du numérique : analyse automatisée des réseaux sociaux, gilets connectés pour les forces de l’ordre, lunettes ou casques augmentés, interconnexion des fichiers biométriques, identification par les empreintes digitales lors des contrôles d’identité, reconnaissance faciale, vocale et d’odeur, vidéosurveillance par drones, etc.
Le deuxième article, Loi sécurité globale : surveillance généralisée des manifestations, décrypte 3 dispositions de cette proposition de loi, actuellement en discussion au parlement : la dérégulation de l’utilisation des caméras mobiles portées par les forces de l’ordre, la légalisation de la surveillance par drone et l’interdiction faite au public de diffuser l’image de policiers ou de gendarmes. L’article analyse comment ces mesures s’inscrivent dans une approche « confrontationnelle » du maintien de l’ordre qui « vise avant tout à dissuader la population de participer à des manifestations », à contrario de l’approche « d’accompagnement » qui vise « la protection des manifestants, le dialogue et la désescalade de la violence ». Cette approche « confrontationnelle » a déjà été mise en œuvre contre les manifestations syndicales et le mouvement des Gilets Jaunes.
Depuis, LQDN a gagné son recours devant le Conseil d’État (la plus haute juridiction administrative) qui a déclaré illégale l’utilisation des drones pour la surveillance des manifestations.
Le troisième article, Décrets PASP[2] expose la manière dont trois décrets permettent le fichage massif de militantes et militants politiques, de leur entourage (y compris de leurs enfants mineurs), de leur santé ou de leurs activités sur les réseaux sociaux. Ces décrets étendent le fichage aux personnes morales et aux groupements.

LQDN appelle donc à ne pas se contenter de supprimer l’article 24[3] et à combattre l’ensemble de la proposition de loi Sécurité globale. Au-delà, LQDN « invite à réfléchir sérieusement au définancement de la police au profit de services publics dont le délabrement plonge la population dans une insécurité bien plus profonde que celle prétendument gérée par la police. ».
La rédaction de Cerises
[1] https://www.laquadrature.net/
[2] Fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique
[3] Article sur l’interdiction de la diffusion d’images de policiers ou de gendarmes
Télétravail, que deviennent les collectifs de travail ?

Les diverses études semblent indiquer que les salariés seraient très favorables au télétravail. En limitant la fatigue liée aux déplacements, les salariés sont plus disponibles pour des activités autres.
Les salariés subissent quotidiennement des pressions, sont mis en compétition les uns avec les autres, sont déconsidérés… L’arrivée des open spaces où tout le monde peut observer tout le monde, où le bruit de fond est permanent, où il est difficile de s’isoler et de se concentrer a rendu insupportables certains lieux de travail. Le télétravail permet de s’éloigner de ces atmosphères anxiogènes voire pathogènes. Mais les salariés pointent aussi le risque de voir disparaître leur collectif de travail. Que ce soit avec les collègues ou avec les chefs, le télétravail individualise les rapports.
Les salariés présents sur site échangent, créent des liens, s’entraident, se forment… Comment s’occuper d’un collègue nouvellement arrivé ? Comment transmettre ses connaissances ou partager ses expériences à distance ? Plus les métiers sont techniques, plus il est nécessaire d’être en présence d’un collectif pour comprendre, apprendre, acquérir les gestes ou intégrer les mécanismes nécessaires au quotidien de travail. La visioconférence ne remplace pas le contact humain et le partage en présentiel.
La visioconférence ne remplace pas le contact humain
Ces échanges peuvent aussi permettre de baisser la pression de la hiérarchie ou de l’extérieur.
Beaucoup de salariés sont infantilisés, jugés peu voire pas capables d’effectuer leur travail seuls sans contrôle d’un supérieur. Avec une telle approche, les salariés perdent toute autonomie, en devant rendre compte régulièrement de leur travail. Dans le cadre du télétravail, la confiance de la hiérarchie est une donnée d’entrée. Si elle n’existe pas, toutes les dérives sont alors possibles. Et selon les capacités du salarié à riposter, l’individualisation du rapport entre le salarié et son chef peut induire davantage de mal être. Dans le cadre d’un collectif, la présence des collègues permet de limiter la véhémence du chef, ou si le chef parvient à « isoler » le salarié, l’échange avec les autres collègues apporte soutien et allège la pression.
Les salariés sont souvent plus productifs à la maison que sur leur lieu de travail. En dehors des avantages que peuvent y trouver les patrons (moins de charges à payer…), les salariés mettent les bouchées doubles à la maison. Les schémas classiques sont bien ancrés dans les esprits. Les salariés ne veulent pas être pris en défaut, alors ils ne comptent plus les heures. Et la frontière entre vie professionnelle et vie privée devient ténue. Et là encore, le collectif n’est pas là pour tirer la sonnette d’alarme.
Le télétravail est une difficulté pour les représentants du personnel. Les patrons qui inondent les boites mails professionnelles de leur communication stérile, refusent aux organisations syndicales l’utilisation de ces mêmes outils. La diffusion d’information repose sur la diffusion de tracts et l’organisation de tournées pour aller à la rencontre des salariés. Or, il est de plus en plus difficile de trouver tout le monde présent ! C’est souvent lors des tournées que les représentants ont connaissance des problèmes ou du non-respect de la réglementation. Les salariés en difficulté se manifestent peu à distance. Cela favorise la position dominante des patrons, rend plus difficile les mobilisations collectives et l’obtention de nouveaux droits.
Il faut regarder l’ensemble des tenants et aboutissants du télétravail. Il s’agit davantage d’une solution momentanée individuelle. Si le télétravail peut permettre à certains de soulager temporairement leur quotidien, le travail reste le résultat d’individus, certes, mais qui évoluent dans un cadre collectif, et moins d’une addition d’individus chacun de son côté.
Le numérique à l’école

Entretien avec Pascal Plantard professeur d’anthropologie des usages du numérique, Université de Rennes2
Cerises : Avec le confinement, élèves et enseignants ont été confrontés à l’enseignement à distance à une échelle jusque-là jamais réalisée. Présentiel, distanciel, continuité pédagogique, la pandémie a mis à l’ordre du jour des concepts nouveaux largement utilisés dans les discours institutionnels. Qu’en est-il de la réalité de terrain ?
Pascal Plantard : Les mots sont importants. Continuité pédagogique est un mot valise qui empêche de penser les problèmes que pose l’enseignement à distance. A commencer par la fracture numérique qui comporte deux aspects : ne pas disposer de l’équipement numérique nécessaire (supports, connexions …) et ne pas posséder le bagage culturel suffisant pour répondre aux différentes injonctions institutionnelles. L’imposition numérique ne va pas de soi.

Dire en mars 2020 que l’Éducation Nationale est prête à organiser l’enseignement à distance était une énorme plaisanterie. 75 % des familles possèdent un ordinateur, et donc 25 % n’en ont pas. Beaucoup de familles populaires accèdent à internet par téléphone. Comment faire du pro note et de l’enseignement à distance avec un téléphone ?
Les inégalités existent aussi chez les enseignants.es qui n’entretiennent pas toutes et tous le même rapport au numérique. Tout le monde ne peut pas faire « La maîtresse part en live.» Si 25 % des enseignants utilisent des outils numériques élaborés (dossiers interactifs, pédagogie coopérative, robotique, codage, wiki, plate-forme d’écriture collaborative…), 50 % utilisent des technologies supplétives (pronote, diaporama, tableau interactif…), 25 % sont en situation de décrochage numérique, ce qui est énorme et l’institution ne s’en préoccupe absolument pas.
Elle ne se préoccupe pas non plus des burn-out et de l’épuisement professionnel générés par la nécessaire adaptation à ces nouvelles contraintes.
Cerises : Pourtant Blanquer revendique de mener une politique éducative audacieuse qui se nourrit de l’apport des neurosciences, il organise les États généraux du numérique. Qu’en penses-tu ?
Pascal Plantard : Loin de moi l’idée de ne pas reconnaître l’apport des neurosciences dans la connaissance des mécanismes de l’apprentissage, mais de là à les fétichiser, il n’y a qu’un pas que franchissent allègrement Blanquer et Dehaene président du Conseil scientifique de l’EN et chargé des États généraux du numérique. Selon eux, les neurosciences et les tenants de l’intelligence artificielle vont pouvoir imposer des logiciels d’apprentissage de la lecture, de l’anglais, du français etc… Il y a une véritable dérive qui consiste à construire des dispositifs à partir de recherches en laboratoire, on n’est pas loin de réinventer Skinner et les techniques behavioristes ! Le vieux fantasme d’un modèle éducatif alternatif via le numérique perdure alors que tous les spécialistes de l’enseignement à distance disent que cela ne marche pas, y compris pour des ingénieurs. On n’apprend rien sans interaction sociale ! De plus la volonté de piloter le déploiement du numérique à l’école, de la rue de Grenelle, est contre-productif, toutes les recherches internationales plaident pour un travail horizontal sur le mode collaboratif et il y a un lien étroit entre les possibles et la réalité des territoires.
Cerises : L’éducation représente un formidable marché pour les GAFAM, le système éducatif peut-il se prémunir de leurs objectifs de prédation ?
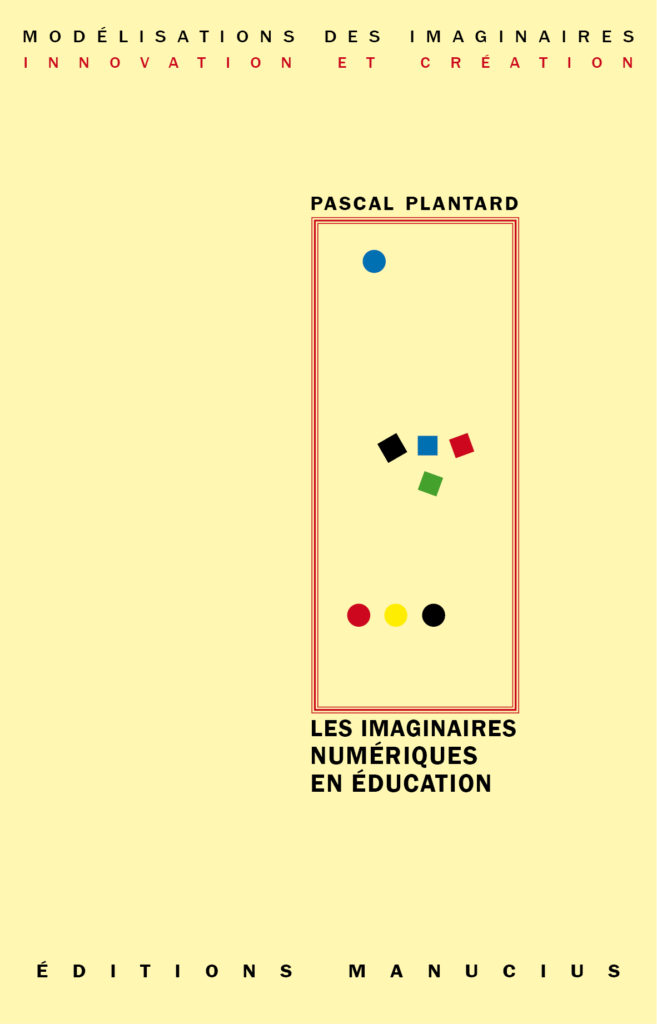
Pascal Plantard : Si les enseignants sont de grands utilisateurs de Google, et les éditeurs de manuels sont fascinés par les GAFAM, il n’en demeure pas moins que de nombreux logiciels utilisés ont été produits par des coopératives ou des petites et moyennes entreprises fonctionnant sur le modèle coopératif et très proches du mouvement du libre. Pronote par exemple a été créé par des enseignants, et des allers-retours existent avec les services informatiques des rectorats pour améliorer l’outil. Sesamaths, Labomep, WebLettres sont des sites et des logiciels éducatifs libres, conçus par des communautés d’enseignants.es organisés en associations, souvent en lien avec les chercheurs en didactique et ils ne sont pas à vendre ! Pour autant, il manque une véritable cohérence dans les politiques publiques du numérique.
Cerises : Le numérique c’est aussi une surveillance généralisée des élèves et des enseignants…
Pascal Plantard : Effectivement ne minimisons pas cette question, les enjeux sont énormes. Pour développer le numérique comme outil d’émancipation, il faut se prémunir de toutes les dérives possibles en matière de surveillance (anonymisation des données, missions de la CNIL…). Si Pronote par exemple est un outil important pour contrôler les absences des élèves et éviter le décrochage scolaire, il ne doit pas servir à faire du contrôle social.
Les plateformes coopératives, alternative aux plateformes capitalistes ?
Accélérer le développement du covoiturage, permettre la création de coopératives locales de logistique à vélo, donner à chaque producteur un moyen de vendre et distribuer sur son territoire des denrées alimentaires en circuit-court, mettre à disposition des commerçants une place de marché numérique gérée localement ou encore mettre en commun la trésorerie des entreprises (si importante en temps de crise) et outiller l’entraide intergénérationnelle : les plateformes coopératives sont des outils critiques pour la résilience des territoires par la juste mobilisation des opportunités du numérique.
Issues des idées d’émancipation des personnes et des territoires à l’origine du développement du numérique et enrichies par l’histoire du mouvement coopératif, les plateformes coopératives amènent un débat de fond sur la citoyenneté et la souveraineté économique de chacun, questionnant les moyens de “faire société” à l’heure du numérique, dans un contexte d’ubérisation des services marchands, mais aussi des moyens de solidarité.
Pendant le confinement lié à la covid-19, le mouvement du coopérativisme de plateformes a fait la preuve qu’il correspondait aux besoins de résilience des territoires, des citoyens, et aussi des acteurs économiques.Le promouvoir, c’est faire le choix de modèles diversifiés, ouverts, décentralisés, reliables les uns aux autres, construits pour une meilleure utilisation des capacités existantes dans les territoires. Le Promouvoir, c’est choisir de tourner le dos à un modèle construit sur la captation de la valeur des territoires par des outils centralisés qui « disruptent » sans précaution les équilibres sociaux, démocratiques, économiques.
Les plateformes coopératives préfigurent un mode d’entrepreneuriat numérique d’un nouveau type : collectif puisqu’il associe directement de nombreuses parties prenantes, social puisqu’il privilégie la pérennité de la collaboration entre ses membres à la rentabilité de court-terme.
Plus que de simples modèles entrepreneuriaux sur un marché concurrentiel de plateformes, ce sont de véritables communs numériques par la spécificité de leurs modèles économiques et juridiques, qui permettent une plus grande démocratie et la propriété partagée entre tous les acteurs qu’elles impactent.
Les plateformes coopératives sont des infrastructures numériques territoriales qui incarnent un intérêt collectif entre citoyens et territoires. On ne peut donc pas exiger d’elles un modèle de rentabilité équivalent aux plateformes capitalistes pour conditionner des investissements adéquats. Les travaux qui ont mené à la rédaction de ce rapport font le constat que les plateformes coopératives intéressent de plus en plus les collectivités locales et leurs tissus économiques. En revanche, parce qu’elles proposent un modèle d’entreprenariat numérique original, appuyé sur les valeurs et les outils de l’économie sociale, elles ne disposent pas des mêmes opportunités que le modèle capitaliste plus courant. Ces structures ne peuvent donc pas exprimer leur plein potentiel.
Le groupe Plateformes en Communs de La Coop des Communs identifie des chantiers pour augmenter leurs capacités d’action, afin que le coopérativisme de plateforme propose à moyen-terme des solutions à la hauteur des enjeux. Il conviendra de mener ces travaux en bonne intelligence avec l’ensemble des institutions et acteurs engagés dans ce processus afin de prouver que dans le numérique aussi, l’économie sociale est un moyen d’entreprendre à part entière. Les entrepreneurs et les collectifs derrière les plateformes existantes ont besoin de soutien et d’accompagnement pour renforcer les succès acquis et continuer d’expérimenter.
Logiciel libre, un apport décisif pour penser et agir pour une rupture radicale du système capitaliste

Le concept de “logiciel libre” est né dans les années 1980 comme une réponse au processus de privatisation de la création intellectuelle qui avait émergé dans le secteur informatique. Jusqu’à la fin des années 1970, l’informatique était dominée par IBM qui a été la première entreprise réellement multinationale. Et à cette époque, l’industrie considérait que la valeur se trouvait dans le matériel, le “hardware”, qui était le seul élément facturé aux clients.
La rupture est apparue en 1981 quand IBM, qui avait méprisé pendant toute la décennie 70 les micro ordinateurs qui étaient mis au point à San Francisco par de nombreuses start-up, dont Apple, a mis au point le “PC”, pour ne pas perdre un segment de marché en pleine expansion. IBM, pour aller vite, a acheté le système d’exploitation de son PC à une toute petite entreprise, Microsoft, créée par Bill Gates qui a demandé que celui-ci soit vendu séparément de l’ordinateur physique. Le logiciel devenait ainsi un élément important de l’industrie informatique et la défense de sa propriété est devenue l’objet d’un conflit majeur.
Face à cette privatisation de la propriété intellectuelle, la première réponse est venue de Richard Stallman, un informaticien libertaire américain, qui a initié une licence, une forme de brevet, qui garantissait aux logiciels qui y souscrivait de rester libre d’accès et de profiter ainsi de toutes les améliorations qui pouvaient être apportées par la communauté des développeurs. Très vite de nombreuses initiatives ont été prises dans ce sens, en profitant de l’essor de l’internet, basé sur des logiciels libres, puis de Linux, qui s’est imposé comme un élément de base de l’informatique moderne, pour les ordinateurs comme pour les smartphones. Cet essor du logiciel libre a rencontré une résistance farouche du logiciel propriétaire, à commencer par Bill Gates, qui a déclaré au début des années 1990 que le logiciel libre était “plus dangereux pour le système capitaliste que le communisme” !
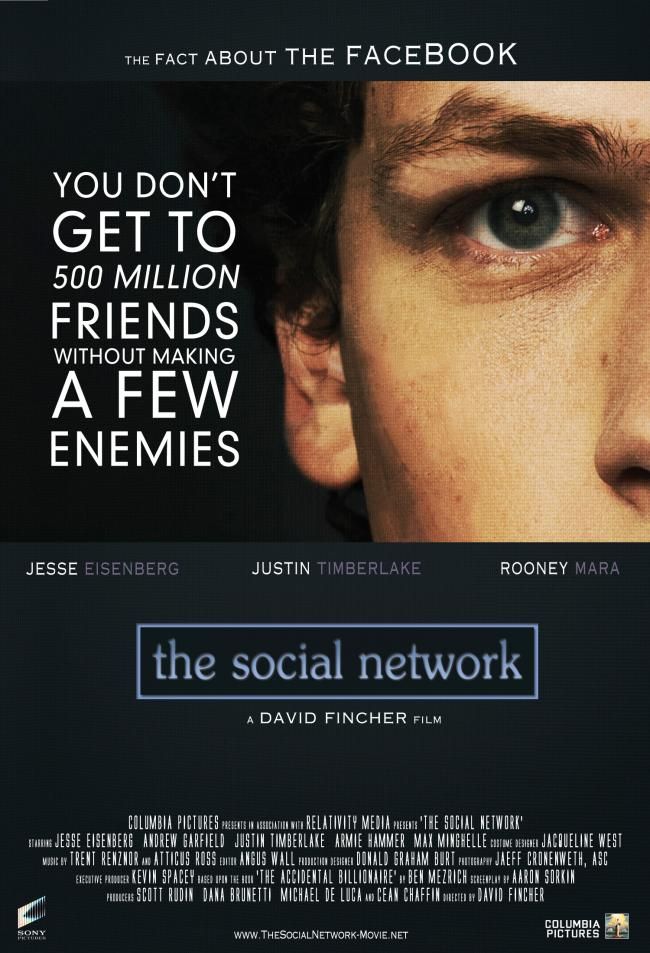
L’importance du logiciel libre tient tout d’abord au fait qu’il a, pour l’essentiel, gagné la bataille face aux logiciels propriétaires qui ne s’imposent plus aujourd’hui que dans des segments très spécialisés. Une victoire qui s’explique par la vivacité de la communauté des développeurs mais aussi par ses qualités intrinsèques. Étant public, le code peut être contrôlé par tous et il permet une élaboration collaborative qui représente une économie essentielle pour tous les acteurs, y compris de nombreuses entreprises. A l’image des services publics émergeant à la fin du 19ème siècle où l’école, la santé ou les systèmes de retraites étaient des revendications portées par le mouvement ouvrier mais également le moyen pour le patronat de mutualiser des coûts que les chefs d’entreprises ne voulaient plus porter seuls. Mais cette victoire ne veut pas dire que la guerre ait été gagnée : des multinationales comme Google utilisent et développent des logiciels libres, mais sont aussi capables de les orienter de telle manière à ce que leurs services s’imposent à tous à l’exemple d’Android pour les smartphones.
Le logiciel libre est tout aussi important car il a lancé un mouvement général pour le développement de contenus “libres” dans tous les secteurs de la connaissances, les articles scientifiques, wikipedia ou openstreetmap, montrant ainsi qu’il est possible de développer des biens communs essentiels pour toute l’humanité comme alternatives au capitalisme mais aussi à l’étatisme !
C’est bon pour les femmes, les gosses et la planète

Le tout numérique libère la femme…
Puisqu’on vous le dit ; l’information et la communication entièrement numérisées sont le levier puissant de l’autonomisation des femmes à travers l’accès à l’information, et les opportunités d’activités économiques… Le tout numérique, invite les femmes à saisir l’opportunité numérique pour surmonter les obstacles sexospécifiques. Ainsi elles sont invitées à endosser leur destinée économique et professionnelle. Désormais autonomes et flexibles, il ne tient qu’à elles de se réinventer, s’engageant dans des projets entrepreneuriaux. Les voici responsabilisées, rationnelles et compétitives. Demeurent-elles, ou non dans la médiocrité voire dans la pauvreté ? Cela ne saurait être que le résultat de leur degré de capacité à mobiliser en elle-même audaces et talents d’entrepreneuses.
Moulinex du XXIe siècle, le commerce numérique libère la femme…
Disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il repousse plus loin encore les exigences du profit et de l’accumulation. Le e-commerce emploie plus de 200 000 personnes en France majoritairement des femmes. Elles travaillent au sein de ces plateformes désormais connues pour leurs salaires extrêmement bas, pour la flexibilité à tout crin où les droits du travail et les mesures de protection sont inexistants inadaptés à l’ère numérique.
Tout numérique : qu’as-tu appris à l’école mon fils…
L’informatique comme elle est enseignée à l’école se fait du seul point de vue de la maîtrise d’un logiciel en particulier, exemple traitement texte, tableur, diaporama disponible soit sur la suite OpenOffice ou bien sur la suite Office. On citera encore GéoGébra destiné en mathématiques aux lycéens et collégiens. On pourrait tout autant citer la myriade de logiciels d’acquisition utilisée en sciences et vie de la terre et physique chimie.
Cela s’inscrit à l’encontre de l’ambition émancipatrice de l’école Au profit d’une école pourvoyeuse de salariés directement employables et jetables le cas échéant car détenteurs d’un savoir-faire extrêmement restreint. Où est l’école utile dans un monde largement envahi par le numérique ? Libératrice en ce qu’elle offrirait l’accès à la notion d’algorithme autrement dit l’accès à la réalité fondamentale de tout logiciel ?
Tout numérique versus écologie où l’on fait grise mine
Il sera question de minage, c’est le mot qui dans le champ de l’échange de monnaie virtuelle désigne la résolution des puzzles nécessaires à la sécurité des transactions de monnaie virtuelle.
Cette tâche coûteuse en ressources numériques est rémunérée par un faible pourcentage de la transaction, les mineurs en sont les bénéficiaires. On désigne ainsi les personnes qui font fonctionner cette machinerie.
À titre d’exemple le minage du bitcoin, qui est la monnaie virtuelle la plus répandue, représente à lui seul l’équivalent de la consommation électrique de la Suisse…
Gracchus Bottin et Catherine Destom-Bottin

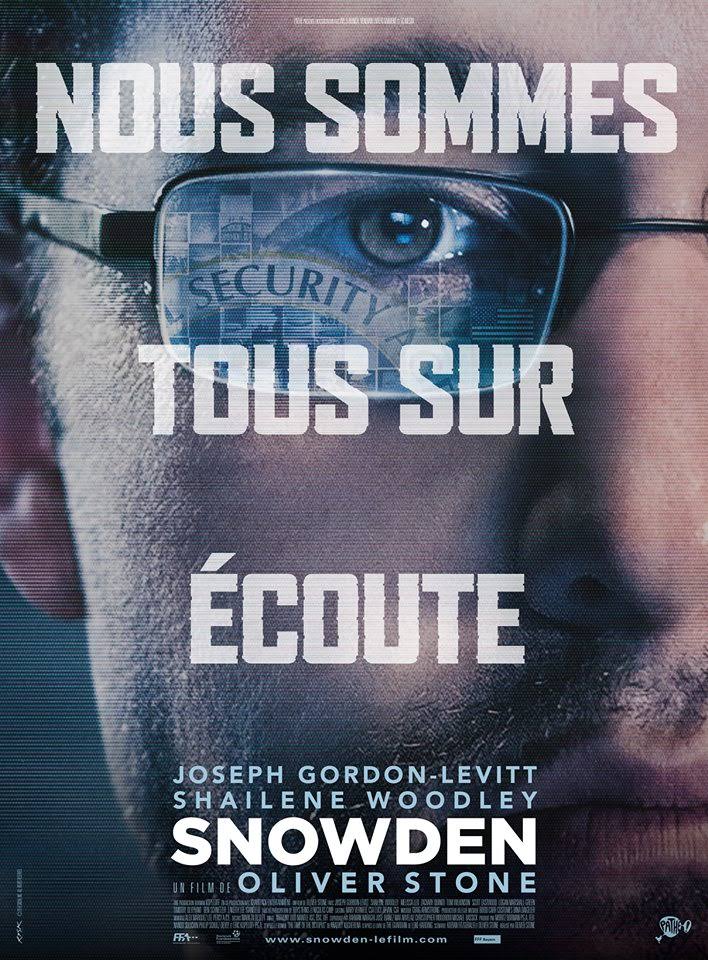

A lire également
Gratuité et émancipation
Démocratie : le pouvoir du peuple ?
Changeons le travail