Partager un livre c’est parler de soi autant que de l’ouvrage et de l’auteur ! Je suis peu porté sur le roman, hormis quelques pôles magnétiques, sources de maintes visitations : des géants sur les épaules de qui se jucher (Melville, Dostoïevski, Dickens, Balzac, Hugo), et une constellation d’excentrés formant une jubilatoire diagonale de fous (de Boccace, Rabelais, Cervantès, Swift, Gogol, Caroll, Poe à Kafka, Jarry, Orwell, Borges, Calvino et Perec). Choisir UN livre suppose d’aller au-delà de ces complicités avec auteurs et ouvrages marquants vers un magnum opus qui nous habite. Duquel vous parler ? L’homme sans qualité, un exercice existentiel de la philosophie ? Vie et destin et l’abîme de l’humanité ? L’art de la joie, désenchainant le genre ? La fin de l’homme rouge, et l’empire des illusions ? 2666, et les infinis paradoxes de la complexité ?
Ce sera L’esthétique de la résistance et l’horizon magnifique et brouillé de l’émancipation, un véritable hymne aux vaincus. Non pas un éloge funèbre sublimant a posteriori des postures héroïques défaites, ni une revanche des (ab)battus vantés par des thuriféraires les trahissant au présent, ni même un hommage vibrant à des frères d’armes, mais une éclatante et cinglante monstration : comment l’espérance d’une résistance pourtant écrasée peut nous éclairer face à nos impératifs. Se tenir debout aux côté des vaincus, dans leurs manières de vivre et comprendre les faits, bienfaits et méfaits, historiquement advenus, ce n’est pas leur donner raison, c’est rendre gorge aux vainqueurs d’hier pour que les dominats d’aujourd’hui ne soient pas les vainqueurs de demain.
« Car le feu qui me brule est celui qui m’éclaire. » Ce que dit Etienne de la Boétie aurait pu être la devise du narrateur anonyme. Ce dernier et ses amis nous relatent au travers leurs regards et vécus quotidiens un moment charnier de maelström historique : le mouvement ouvrier depuis Weimar jusqu’à la chute du IIIème Reich. C’est une véritable épopée de la gauche révolutionnaire sous le fascisme, le nazisme, le stalinisme et le franquisme où les coups ne viennent pas seulement de là où on les attend. Ce n’est pas une chronique d’apprentissage et de combat. C’est une tentative titanesque de reconstitution d’une mémoire collective en des temps où des conflits de classes et de nations traversent et constituent les individualités de part en part. Le « je » du récit est toujours un « nous ».
Les descriptions minutieuses concomitantes ou asynchrones du roman comportent des changements de focal (micro/macro) : l’occupation de l’Autriche, les attaques de phalangistes contre les républicains dans les villes catalanes et les procès de Moscou sont au cœur des conversations des protagonistes en même temps que la structure patriarcale et chauvine du Parti.
Le roman se déploie encore avec des changements de points de vue et de champs ouvrant d’autres possibles émancipateurs. Les discussions passionnées et passionnantes sur des chefs d’œuvres de peinture, architecture ou littérature (Kafka, Gaudi, Picasso, Géricault…) ne sont pas des digressions où l’art constituerait un rare moment de fuite, de répit, un refuge ou une délectation. Elles font de l’expérience esthétique vécue un facteur en soi de fabrique de sens ouvrant d’autres horizons d’humanité.
Le verbe puissant, P. Weiss nous embarque, nous alerte et nous subjugue pour nous faire parvenir ce feu vif et sacré de quelques uns devant tant d’obstacles barrant les routes. Il nous encourage surtout à inventer ici et maintenant nos propres arts de la résistance dans les tempêtes actuelles. Son narrateur aurait pu avoir aussi pour devise ces vers de Hölderlin : « sans cesse, poétiquement l’homme habite le monde » et « là où croit le danger croît aussi ce qui sauve ».
Makan Rafatdjou
Peter Weiss : L’Esthétique de la résistance, 888 pages, Kliencksiek, nouvelle édition en un volume 2017, 35,50 €.

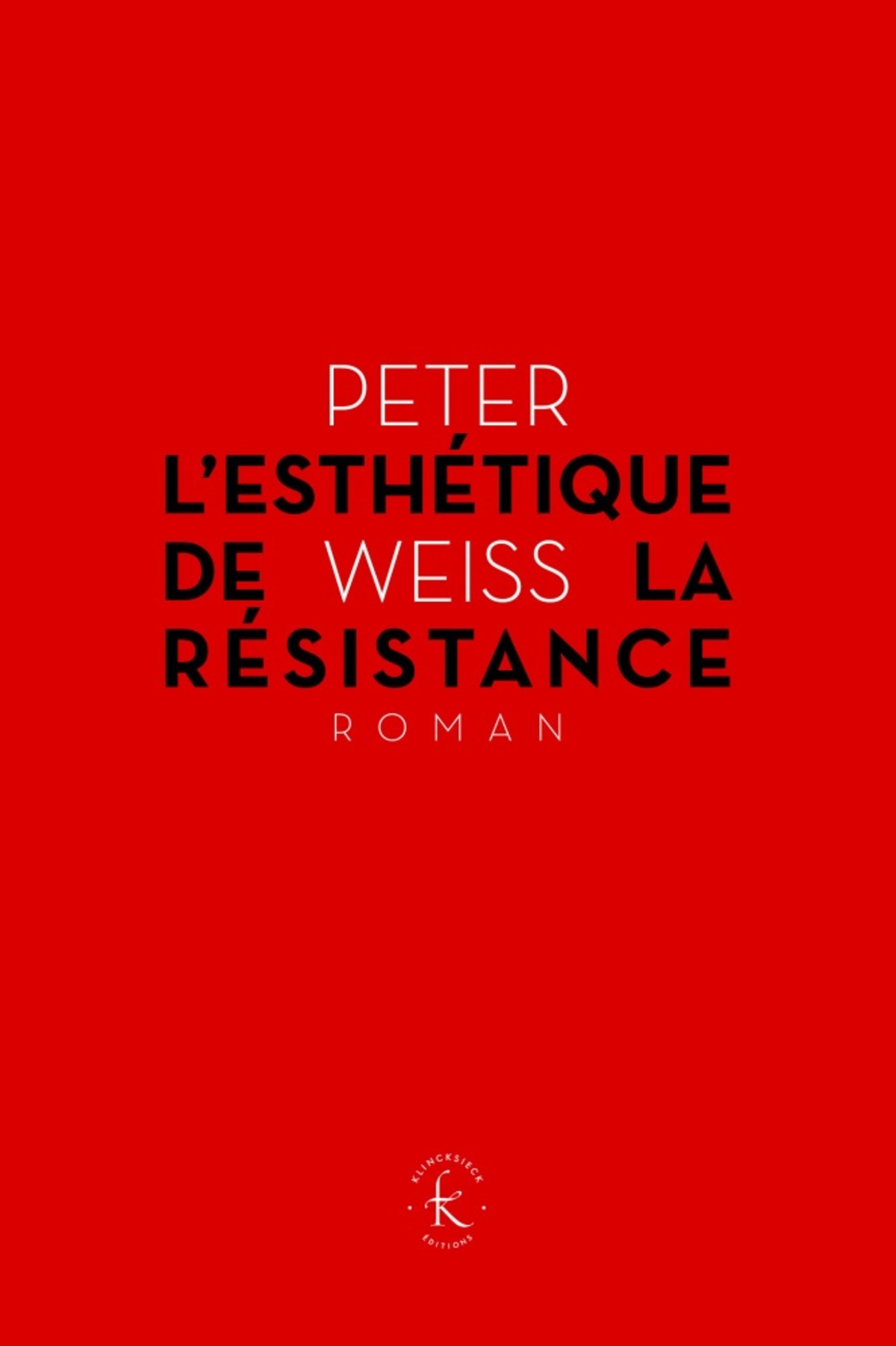


A lire également
Quid de l’organisation révolutionnaire ?
Le conflit pour faire démocratie
Rennes, une citoyenne à la mairie