Historienne, l’autrice déploie depuis de nombreuses années sa fidélité inventive à la Révolution Française par une approche singulière de cet évènement fondateur pour éclairer les débats politiques et les mobilisations citoyennes d’aujourd’hui. Elle pointe comment les révolutionnaires, conscients des risques majeurs d’explosion sociale et de guerre civile, ont tenu à instituer des lieux où le peuple rassemblé puisse sublimer sa sensibilité comme faculté de juger. Les sentiments républicains (l’amour, l’amitié, le courage, la confiance, la foi en l’impossible…) sont sollicités alors pour réduire la division sociale et promouvoir le pouvoir politique de chaque citoyen-ne pour une maîtrise des destins individuels et des destinées collectives.
Nous sommes affecté-e-s au quotidien par ce que nous vivons singulièrement et par ce qui nous arrive avec nos semblables. Le potentiel empathique de ces sentiments sociaux peut être un solide ferment de logiques inclusives de rassemblement et de renforcement des liens sociaux pour faire société ensemble. Leur déni mésestimant leur rôle cardinal, ou déconsidération sous-estimant leur portée, peut au mieux être source de désaffection politique et de déliaison sociale, et au pire de ressentiments exclusifs où se conjuguent des logiques mortifères de la sympathie de l’entre-soi et de l’antipathie du bouc-émissaire.
C’est tout le défi de la reconnaissance d’une raison sensible dont le partage est un enjeu décisif pour la démocratie.
Makan Rafatdjou
La révolution des sentiments, Comment faire une cité 1789-1794, Sophie Wahnich, Éditions du Seuil, 2024 , 398 pages, 24 euros

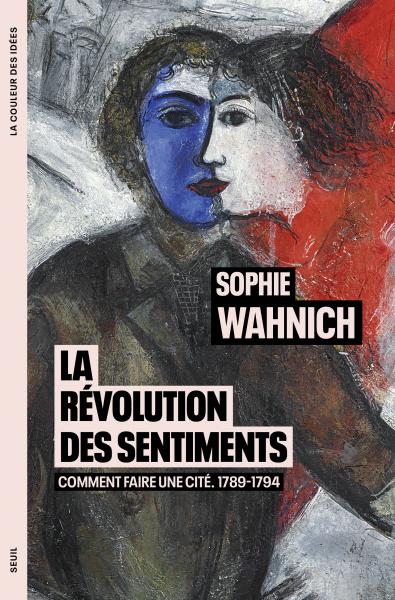

A lire également
Les invisibles
« Retour à Heillange »
Monsieur